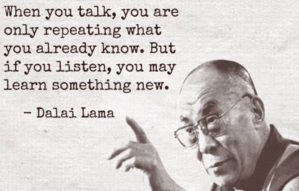-
Par gervanne le 26 Avril 2014 à 21:44

 Dans mon petit village, en avril dernier, un vieil homme, 86 ans, avait préféré mettre fin à ses jours plutôt que d'aller à l'hôpital. Il s'appelait Marcel Bertonnier, avait d'abord été ce que, jadis, on appelait un "trimardeur", c'est à dire qu'il avait loué sa force physique dans des fermes un peu partout en France. Puis, il était venu s'installer comme croque-mort dans la région. Il connaissait mieux que personne les coins à champignons de la région. Surtout, il en était la mémoire en racontant avec talent toutes les histoires, y compris celles qui remontaient à l'Antiquité. Je ne suis pas sûr que notre temps de téléréalité sache soupeser le vrai poids de ce type de personnage. Pour manifester que je n'oublie pas ce beau profil, je republie ici le portrait que j'avais fait de lui, il y a quelques années. Et puis j'aime bien l'idée que des articles anciens puissent revivre.
Dans mon petit village, en avril dernier, un vieil homme, 86 ans, avait préféré mettre fin à ses jours plutôt que d'aller à l'hôpital. Il s'appelait Marcel Bertonnier, avait d'abord été ce que, jadis, on appelait un "trimardeur", c'est à dire qu'il avait loué sa force physique dans des fermes un peu partout en France. Puis, il était venu s'installer comme croque-mort dans la région. Il connaissait mieux que personne les coins à champignons de la région. Surtout, il en était la mémoire en racontant avec talent toutes les histoires, y compris celles qui remontaient à l'Antiquité. Je ne suis pas sûr que notre temps de téléréalité sache soupeser le vrai poids de ce type de personnage. Pour manifester que je n'oublie pas ce beau profil, je republie ici le portrait que j'avais fait de lui, il y a quelques années. Et puis j'aime bien l'idée que des articles anciens puissent revivre."Qu'il pleuve ou qu'il vente, vous le croiserez sur les sentiers de la Gervanne. Marcel Bertonnier, 82 ans (à l'époque) et une forme superbe, le martèle: « ma promenade quotidienne, elle est mé-di-cale. Une heure- une heure et demi, pas plus. La distance je m'en moque. Mais la durée, je m'y tiens. » Le visage est buriné et creusé par les rides, l'allure incroyablement svelte pour un homme de son âge et surtout après une vie comme la sienne. Ah, ça oui, quelle vie! Ouvrier agricole pendant trente bonnes années et fossoyeur pendant quinze ans encore. Comme tel bien sûr, il est porteur de la mémoire de nos campagnes, mais c'est aussi pour ses marottes qu'il faut l'interroger, sa passion des monnaies gauloises et romaines qu'il est allé dénicher dans tous les champs de la région avec sa « poêle à frire ». Sa passion aussi des champignons qui lui a valu de la part de notre ancien confrère du Dauphiné Libéré, Henry Combes, le titre de « meilleur chercheur de champignons de la Drôme ». Il sourit: « Oh, c'était peut-être exagéré. Vous savez bien: les journalistes ça exagère toujours... »
 REPARTIR SUR LE TRIMARD.-Marcel Bertonnier est né à Saint Péray, « un pays d'alcooliques, à cause de leur bon vin blanc ». La vie y est dure. Sa mère ramasse des champignons pour vivre, ce qui lui offrira un fort utile apprentissage. A douze ans, au début de la guerre, on l'envoie garder les vaches dans les montagnes d'Ardèche. Cela le préservera un peu de la dureté des temps, mais l'en laissera témoin tout de même: « je voyais des patriotes qui sortaient des maquis. Je me souviens d'un qui m'a fait essayer sa mitraillette qu'il venait de recevoir d'un parachutage. Des hauteurs où j'étais, j'ai pu voir la bataille autour de Valence. Je me souviens de trois forteresses volantes abattues par la flack allemande autour de la ville. »
REPARTIR SUR LE TRIMARD.-Marcel Bertonnier est né à Saint Péray, « un pays d'alcooliques, à cause de leur bon vin blanc ». La vie y est dure. Sa mère ramasse des champignons pour vivre, ce qui lui offrira un fort utile apprentissage. A douze ans, au début de la guerre, on l'envoie garder les vaches dans les montagnes d'Ardèche. Cela le préservera un peu de la dureté des temps, mais l'en laissera témoin tout de même: « je voyais des patriotes qui sortaient des maquis. Je me souviens d'un qui m'a fait essayer sa mitraillette qu'il venait de recevoir d'un parachutage. Des hauteurs où j'étais, j'ai pu voir la bataille autour de Valence. Je me souviens de trois forteresses volantes abattues par la flack allemande autour de la ville. » La paix revenue, il faut trouver un métier. Et, décidément, le goût des grands espaces acquis dans l'adolescence lui reste. Il aura bien l'occasion de se faire embaucher dans un immense consortium sidérurgique, à Rombas, à la frontière luxembourgeoise, « grand comme d'ici à Montélimar, avec des trains qui le sillonnaient ». Mais il y fait trop froid, il y a du brouillard et puis non décidément, ça n'est pas son monde! « J'ai eu un copain qui est allé se faire embaucher aux mines de Saint-Etienne. Je lui ai dit « vas-y, tu n'es pas prêt de m'y voir » ». Alors, il va de ferme en ferme, en Languedoc, en Seine et Marne, un peu partout. Il moissonne, il vendange. Chaque fois on l'apprécie. Mais il n'aime guère s'attarder. « A Vinsobres, j'ai eu un patron qui me disait « installe toi, reste dans le coin, on te facilitera les choses ». Mais non! Je suis un peu comme un gitan. Au bout de quelques temps, je voulais repartir sur le trimard ». Des années plus tard, son patron de Vinsobres fera une confidence à Etienne Audibert, de Suze: « Celui là, s'il avait voulu, il serait devenu l'homme le plus riche de Vinsobres! »
La paix revenue, il faut trouver un métier. Et, décidément, le goût des grands espaces acquis dans l'adolescence lui reste. Il aura bien l'occasion de se faire embaucher dans un immense consortium sidérurgique, à Rombas, à la frontière luxembourgeoise, « grand comme d'ici à Montélimar, avec des trains qui le sillonnaient ». Mais il y fait trop froid, il y a du brouillard et puis non décidément, ça n'est pas son monde! « J'ai eu un copain qui est allé se faire embaucher aux mines de Saint-Etienne. Je lui ai dit « vas-y, tu n'es pas prêt de m'y voir » ». Alors, il va de ferme en ferme, en Languedoc, en Seine et Marne, un peu partout. Il moissonne, il vendange. Chaque fois on l'apprécie. Mais il n'aime guère s'attarder. « A Vinsobres, j'ai eu un patron qui me disait « installe toi, reste dans le coin, on te facilitera les choses ». Mais non! Je suis un peu comme un gitan. Au bout de quelques temps, je voulais repartir sur le trimard ». Des années plus tard, son patron de Vinsobres fera une confidence à Etienne Audibert, de Suze: « Celui là, s'il avait voulu, il serait devenu l'homme le plus riche de Vinsobres! » ANGUILLES A LA MATELOTTE.-Mais le goût de la route est là, même si Marcel Bertonnier s'est tout de même installé à Gigors où, à la mauvaise saison, il va donner un coup de mains aux paysans dans les montagnes. Aux beaux jours, il file près de Béziers faire les vendanges: « C'était rude! Des heures et des heures à porter à deux des bacs de 80 kilos ». Ailleurs, dans la région parisienne, ce sont les moissons. « Ah, couper la paille, ça c'était dur. Pas de machine dans ce temps là. Tout à la main. » Mais il faut dire que le gaillard était costaud « Quatre vingt kilos, pas un poil de graisse ». Alors, on l'aimait bien. « J'ai eu un patron en Seine et Marne qui m'envoyait un billet de train pour que je revienne. » N'empêche que souvent la nuit c'est sur la paille. Et il se souvient encore avec tendresse de ce patron qui, lui du moins, le nourrissait avec le même menu que le sien « Ah, ces anguilles à la matelotte... ».
ANGUILLES A LA MATELOTTE.-Mais le goût de la route est là, même si Marcel Bertonnier s'est tout de même installé à Gigors où, à la mauvaise saison, il va donner un coup de mains aux paysans dans les montagnes. Aux beaux jours, il file près de Béziers faire les vendanges: « C'était rude! Des heures et des heures à porter à deux des bacs de 80 kilos ». Ailleurs, dans la région parisienne, ce sont les moissons. « Ah, couper la paille, ça c'était dur. Pas de machine dans ce temps là. Tout à la main. » Mais il faut dire que le gaillard était costaud « Quatre vingt kilos, pas un poil de graisse ». Alors, on l'aimait bien. « J'ai eu un patron en Seine et Marne qui m'envoyait un billet de train pour que je revienne. » N'empêche que souvent la nuit c'est sur la paille. Et il se souvient encore avec tendresse de ce patron qui, lui du moins, le nourrissait avec le même menu que le sien « Ah, ces anguilles à la matelotte... ».S'il n'avait pas été ouvrier agricole, Marcel Bertonnier aurait du être journaliste, écrivain peut être même. Parce qu'il a une manière de génie de l'observation, une drôlerie pour croquer les hommes et les situations. Comme ce patron, assis sur l'aile de sa voiture, chaussé de bottes superbes qui lui dit:
-
Je te préviens ici, si on est pas content, on te vire tout de suite
Et lui de répondre:
-
Ca tombe bien, moi quand je me plais pas, je ne suis pas long à partir.
Et, on s'en doute, ces deux hommes se sont bien entendus. Ou bien c'est un riche propriétaire dont il raconte des chasses avec des « grossiums », comme il dit. « Ils avaient fait ménager, en pleine nature, des portes en bois où chaque invité était placé. Les gardes chasses rabattaient le gibier qui pullulait et les gars avaient en tout et pour tout à s'agenouiller pour tirer. Tu parles d'un effort! Et lorsqu'ils en ont eu assez ils ont été festoyer avec des jeunes dames! »
 DES SQUELETTES EN RAYONS DE SOLEIL.-Autour de la quarantaine, Marcel Bertonnier s'est un peu lassé et a saisi l'opportunité de devenir fossoyeur pour une dizaine de communes, notamment Cobonne, Suze, Plan de Baix, mais parfois plus loin encore comme Aubenasson. « Un jour, pour les funérailles d'une comtesse, j'ai trouvé là bas, en creusant des squelettes disposés comme les rayons du soleil, autour d'une pierre. C'est une pratique gauloise. Un de mes amis avait fait la même constatation sur le plateau d'Anse, au dessus d'Omblèze ». Et ce fossoyeur curieux de tout va enregistrer toute ses découvertes. « A Suze, la chapelle du cimetière de Chausséon doit dater de Charlemagne. Un jour, en creusant, j'ai trouvé une sépulture protégé par des lauzes, comme on faisait jadis, mais d'un incroyable étroitesse. On n'aurait jamais pu y mettre un homme. Sauf si ce n'était que des ossements, après qu'on ait brulé le corps, comme ce fut le cas, au moment de la grande peste ».
DES SQUELETTES EN RAYONS DE SOLEIL.-Autour de la quarantaine, Marcel Bertonnier s'est un peu lassé et a saisi l'opportunité de devenir fossoyeur pour une dizaine de communes, notamment Cobonne, Suze, Plan de Baix, mais parfois plus loin encore comme Aubenasson. « Un jour, pour les funérailles d'une comtesse, j'ai trouvé là bas, en creusant des squelettes disposés comme les rayons du soleil, autour d'une pierre. C'est une pratique gauloise. Un de mes amis avait fait la même constatation sur le plateau d'Anse, au dessus d'Omblèze ». Et ce fossoyeur curieux de tout va enregistrer toute ses découvertes. « A Suze, la chapelle du cimetière de Chausséon doit dater de Charlemagne. Un jour, en creusant, j'ai trouvé une sépulture protégé par des lauzes, comme on faisait jadis, mais d'un incroyable étroitesse. On n'aurait jamais pu y mettre un homme. Sauf si ce n'était que des ossements, après qu'on ait brulé le corps, comme ce fut le cas, au moment de la grande peste ».A force de retourner la terre, Marcel Bertonnier s'est passionné pour les pièces qu'il y trouvait. Il tend son porte clef. On y voit d'étranges cercles dorés, des rouelles, « des prémonnaies », comme il dit. « Je le ai trouvées mélangées à des pièces gauloises. On peut donc penser que ça remonte au tout début de l'apparition de la monnaie pour les échanges ». D'une vieille boîte de cigares métalliques, il sort d'autres prises qu'il a faites, des pierres taillées, nettement antérieures, qui témoignent du temps où on les utilisait à défaut de maîtriser encore le métal. Et à force d'avoir trotté dans la région, à force d'y avoir ramassé des morceaux de tuiles, il s'est forgé une conviction: « IL devait y avoir un village romain plus grand que le vieux village de Beaufort, plus loin en allant vers Plan de Baix, dans la combe qui sépare cette route de celle de l'Escoulin ».
 RACHETE MA SELLE.- Et comme, avec ce mystérieux conteur, tout est toujours affaire de belles histoires, ne manquons pas celle-ci qui concerne Mandrin, le fameux bandit du XVIII° siècle, dont Marcel Bertonnier connaît les chemins d'accès au Vercors. « On a bien connu dans la région, une famille très fortunée, les Gailhard-Bancel. Un de leurs ancêtres avait protégé Mandrin. Le jour où il fut roué vif à Valence, il passa, en allant à son supplice, devant son ancien protecteur et lui souffla « Rachète ma selle ». Ce que le Gailhard-Bancel en question fit, lors de la dispersion des biens du brigand. Et il se dit que dans la selle se trouvaient les plans conduisant au trésor de Mandrin. D'où la fortune familiale... »
RACHETE MA SELLE.- Et comme, avec ce mystérieux conteur, tout est toujours affaire de belles histoires, ne manquons pas celle-ci qui concerne Mandrin, le fameux bandit du XVIII° siècle, dont Marcel Bertonnier connaît les chemins d'accès au Vercors. « On a bien connu dans la région, une famille très fortunée, les Gailhard-Bancel. Un de leurs ancêtres avait protégé Mandrin. Le jour où il fut roué vif à Valence, il passa, en allant à son supplice, devant son ancien protecteur et lui souffla « Rachète ma selle ». Ce que le Gailhard-Bancel en question fit, lors de la dispersion des biens du brigand. Et il se dit que dans la selle se trouvaient les plans conduisant au trésor de Mandrin. D'où la fortune familiale... »
 EN PUBLIANT CE TEXTE, J'OFFRE GRATUITEMENT UN ÉLÉMENT DES ARCHIVES DU CRESTOIS. MAINTENONS DANS NOTRE RÉGION UN JOURNAL INDÉPENDANT QUI NOUS SOUTIENT.
EN PUBLIANT CE TEXTE, J'OFFRE GRATUITEMENT UN ÉLÉMENT DES ARCHIVES DU CRESTOIS. MAINTENONS DANS NOTRE RÉGION UN JOURNAL INDÉPENDANT QUI NOUS SOUTIENT. votre commentaire
votre commentaire
-
-
Par gervanne le 21 Avril 2014 à 09:02

 Dans le petit coin de Drôme où je vis, a longtemps vécu, une de ces belles figures de la campagne qui ont travaillé durement pour nourrir les leurs. Il s'appelait Fernand Raillon et, en 2010, je lui avais consacré dans Le Crestois, l'hebdomadaire local, un portrait. Il est mort cette année 2014, au terme d'une ultime période passée dans une maison de retraite de Bourdeaux. Les échos de ces derniers mois que m'en laissait sa famille emplissaient de tristesse.
Dans le petit coin de Drôme où je vis, a longtemps vécu, une de ces belles figures de la campagne qui ont travaillé durement pour nourrir les leurs. Il s'appelait Fernand Raillon et, en 2010, je lui avais consacré dans Le Crestois, l'hebdomadaire local, un portrait. Il est mort cette année 2014, au terme d'une ultime période passée dans une maison de retraite de Bourdeaux. Les échos de ces derniers mois que m'en laissait sa famille emplissaient de tristesse.Je reprends ici, en l'enrichissant puisque la place ne m'est pas comptée, de quelques souvenirs, le texte paru en 2010. « Fernand Raillon reçoit , dans la très haute demeure, à la facade sévère du centre de Beaufort qui fut jadis une auberge. Sa devise était « On loge à pied et à cheval chez Malleval ». Le nom vient de la famille de son exquise épouse, Lucie, hélas trop tôt disparue et dont tout Beaufort se souvient comme d’une femme solide et généreuse. Elle a élevé dix enfants, quatre auxquels elle a donné vie, trois garçons et une fille, et six qui étaient des enfants de l’Assistance, comme on disait alors. « Fallait les tenir » se souvient aujourd’hui Fernand Raillon qui a eu droit au plus beau compliment de l’un d’entre eux, des années plus tard : « Ah, si tu ne nous avais pas dressés, on aurait fait de belles bêtises ».
Fernand Raillon reçoit aujourd’hui, dans sa cuisine. Il porte une veste qui fût tricotée par Lucie et qui est comme un rappel de tous les instants de cette femme auquel il fut tant lié. Sa chaise est adossée à une cuisinière qui diffuse une belle chaleur dans ce qui fut jadis la salle de l’auberge. Au moment des grands froids de 1956, malgré les bâches qu’on avait mises contre la porte-fenêtre qui donnait sur la rue, il y faisait…4°.Dans l’étable, non loin, c’était un peu mieux, 8°, parce que les vaches dégageaient de la chaleur. L’anecdote est à la mesure de la dureté des temps qu’a traversés Fernand Raillon.
 PAS D’EAU COURANTE.- Il est né à Montclar en 1918. Au début des années trente, ses parents s’installent sur le plateau des Chaux, au dessus de Beaufort, non loin des fameux Trois Prés, qui sont un repère connu de tous les gens de la région. Il va à l’école à Lozeron. « En ce temps là, rappelle-t-il, il y avait des écoles dans tous les villages ». Il va aider, ainsi que son frère, pendant quelques années son père à la ferme et prendre très tôt le goût de la chasse qui ne l’a pas quitté. « J’ai eu mon premier permis à 18 ans » et aujourd’hui encore, son fils Gérard ou un de ses petits fils passent le prendre pour l’emmener faire le coup de feu. « Mais cette année, je n’ai pas tiré un coup de fusil. Pourtant, j’ai vu deux lièvres. Mais je préfère le lapin de garenne ».
PAS D’EAU COURANTE.- Il est né à Montclar en 1918. Au début des années trente, ses parents s’installent sur le plateau des Chaux, au dessus de Beaufort, non loin des fameux Trois Prés, qui sont un repère connu de tous les gens de la région. Il va à l’école à Lozeron. « En ce temps là, rappelle-t-il, il y avait des écoles dans tous les villages ». Il va aider, ainsi que son frère, pendant quelques années son père à la ferme et prendre très tôt le goût de la chasse qui ne l’a pas quitté. « J’ai eu mon premier permis à 18 ans » et aujourd’hui encore, son fils Gérard ou un de ses petits fils passent le prendre pour l’emmener faire le coup de feu. « Mais cette année, je n’ai pas tiré un coup de fusil. Pourtant, j’ai vu deux lièvres. Mais je préfère le lapin de garenne ».C’est donc son mariage avec la merveilleuse Lucie qui va l’amener à Beaufort. C’est un temps –l’avant guerre et même au-delà- où il n’ y a pas d’eau courante à Beaufort. On va s’approvisionner à des fontaines. Il faut souvent faire la queue, surtout au moment des grandes chaleurs. « Avec les bêtes qu’il fallait faire boire, c’était pénible ». Il faudra, après le conflit mondial, toute l’habileté de Henri Morin devenu maire, pour changer la situation. Les plus anciens du pays se souviennent encore, pour s’en amuser, d’une polémique qui agita alors la région lorsque la commune acheta, mine de rien, un terrain à Suze, la commune voisine, terrain dont le vrai trésor était le sous sol. Il y avait une source.. C’est elle qui a approvisionné la commune en eau. « Et il a fallu que trois malheureux Italiens creusent toute la tranchée à la main, à un mètre de profondeur pour y mettre la canalisation ». Fernand Raillon le répète souvent : « C’était tout à bras. Pas de machine ».
Il faut dire qu’il parle d’expérience. Car, pour faire tourner la petite exploitation de son beau-père tombé malade, il l’a fait de ses mains. « Au début, j’ai attelé les vaches. Mais ça n’était pas bon pour la production de lait. Alors j’ai acheté deux chevaux. C’était
 rudement plus commode. »
rudement plus commode. »Tout cela faisait vivre quelques artisans : il y avait deux maréchaux ferrants. Léopold* et Charles Colomb fabriquaient même sur place des charrettes ou cerclaient les roues de métal, après avoir chauffé la bande métallique pour qu’elle se dilate. On jetait de l’eau sur le métal rougi, une fois que le cercle était bien en place, pour provoquer sa rétraction rapide et ainsi le faire tenir. « On n’avait pas beaucoup de souci avec les charrettes, mais bien sûr, fallait pas verser. Parfois on cassait une roue. » Et il fallait retourner voir les Colomb. Les photos que je publie ici, du fonds Édouard Mouriquand ont été prises à Beaufort à la toute fin des années 40 et représentent à l'évidence des maréchaux ferrants. Il se peut bien que ce soient les Colomb

 DES BALLES DE 100 KILOS SUR LE DOS.- Leur métier a disparu comme les trois cordonniers, les trois épiceries, sans compter les bistrots dont on voit encore des traces en regardant très attentivement les façades du village où se devinent des enseignes que le temps efface.
DES BALLES DE 100 KILOS SUR LE DOS.- Leur métier a disparu comme les trois cordonniers, les trois épiceries, sans compter les bistrots dont on voit encore des traces en regardant très attentivement les façades du village où se devinent des enseignes que le temps efface.Faute de machine, il y avait les coups de mains entre les hommes. Fernand Raillon évoque volontiers la solide camaraderie qui le liait à Abel Lacroix, un autre agriculteur, dont les anciens se souviennent bien, lui et son imposante Citroën 15 CV. Ceux qui se souviennent de cet Abel là, revoient sa maison au coeur du village dans laquelle on entrait par le garage en longeant donc l'énorme Citroën 15, puis on entrait dans la cuisine où régnait une chaleur étouffante. « Au moment où il fallait battre la récolte de blé, on se donnait la main », poursuit Fernand Raillon. Ca durait bien un mois autour du 14 juillet, puisque ça se prolongeait même au-delà de l’ancienne vogue du village, le 31 juillet. « Les grains étaient vendus à la coopérative de Crest. Deux gars venaient en camion charger des balles de 100 kilos, qu’ils chargeaient sur leur dos. » Fernand Raillon reste rêveur un instant et ajoute : « Ca, je peux vous dire, c’était des gars solides »
L’après guerre fut un temps où se trouvaient au village des prisonniers de guerre qui aidaient dans les fermes au titre de la reconstruction. Il en reste une trace aujourd’hui encore au champ de foire de Beaufort avec le long bâtiment aveugle où, longtemps, les sapeurs-pompiers du village ont entreposé du matériel. Il y en avait alors plusieurs identiques à cet endroit où vivaient les prisonniers nourris par un cuisinier français. « Il y en avait des braves. Je me souviens d’un qui disait « moi la guerre, je l’aurais jamais faite ». Mais ils n’étaient pas tous comme ça. Il y avait des rudes gaillards aussi, des sacrés têtes carrées».
Le champ de foire, où étaient abrités ces prisonniers, avaient bien mérité son nom. « Il y avait cinq foires avant guerre. Le village était envahi de gens qui venaient de partout avec des troupeaux à vendre, avec des poules et des canards. Après guerre, les camions ont permis de transporter les animaux et les foires ont disparu ».
Et on a commencé à voir circuler des tracteurs. C’est au début des années 60, que Fernand Raillon a eu son premier. « Un Mc Cormick de 20 CV. Je suis resté fidèle à la marque par la suite. » Car, ultérieurement Fernand Raillon a pu en acheter un de 30 CV et finalement, en 1970 environ, un de 52 CV qu’il a toujours, même si, bien sûr, il ne s’en sert plus. « Ca permettait d’avoir deux socs pour labourer. Je l’ai payé deux millions de francs de l’époque ». Alors, les chevaux, bien sûr, sont passés de mode. Mais les vaches, elles, mettaient du beurre dans les épinards et sont restées. Chaque matin, il y avait une petite queue devant chez les Raillon pour venir y acheter le lait.
 LE LINGE DANS LA BROUETTE.- La vie était rude aussi pour les femmes. Longtemps, on est allé laver à la Scie, en contrebas. « Lucie mettait le linge sur une brouette et puis elle poussait. Des fois, je pouvais l’accompagner avec la charrette. » Lorsqu’on lui pose la question de savoir si cette vie était dure, Fernand Raillon qui n’est pas homme à se plaindre répond sans détour : « Oui, c’était très dur ». Et il y revient : « C’était tout à bras. »
LE LINGE DANS LA BROUETTE.- La vie était rude aussi pour les femmes. Longtemps, on est allé laver à la Scie, en contrebas. « Lucie mettait le linge sur une brouette et puis elle poussait. Des fois, je pouvais l’accompagner avec la charrette. » Lorsqu’on lui pose la question de savoir si cette vie était dure, Fernand Raillon qui n’est pas homme à se plaindre répond sans détour : « Oui, c’était très dur ». Et il y revient : « C’était tout à bras. »Mais, il y avait, en compensation la chaleur d’une famille où tout le monde a fini par trouver une place dans la vie. Noël Raillon a longtemps été facteur à La Clastre où la population se souvient encore de son dévouement. André fut pompier à Paris, avant de se réinstaller dans la région. Madeleine a travaillé dans les hôpitaux à Lyon, mais elle aussi est revenue à l’âge de la retraite et Georges travaille dans une entreprise de bâtiment d’Aouste.
Et tous ceux qui connaissent un peu cette nichée, voient régulièrement des voitures arrêtées devant la haute façade grise. Ce ne sont plus – et depuis bien longtemps- des clients de l’Auberge Malleval. Ce sont les enfants et les petits enfants de ce patriarche courageux qui viennent écouter ces si belles histoires.
*Michèle Colomb Nottet, petite fille de Léopold, m'adressa une correspondance à la suite de la parution de cette article dans lequel elle le décrivait comme un « génial bricoleur qui a inventé une machine à laver » (en un temps, rappelons le, où cela n’existait pas) « qui fabriquait des vélos pour sa famille, qui arrangeait les automobiles, allant même jusqu’à les recarosser. Musicien à ses heures, puisqu’il avait dirigé l’harmonie du village, il était né le 19 août 1889 à Beaufort. Eugène Charles Alexandre était aussi charron et cousin du premier.

 EN PUBLIANT CE TEXTE, J'OFFRE GRATUITEMENT UN ÉLÉMENT DES ARCHIVES DU CRESTOIS. MAINTENONS DANS NOTRE RÉGION UN JOURNAL INDÉPENDANT QUI NOUS SOUTIENT.
EN PUBLIANT CE TEXTE, J'OFFRE GRATUITEMENT UN ÉLÉMENT DES ARCHIVES DU CRESTOIS. MAINTENONS DANS NOTRE RÉGION UN JOURNAL INDÉPENDANT QUI NOUS SOUTIENT.  votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Histoire,politique, géopolitique, questions religieuses, univers des médias, petites nouvelles de la Drôme