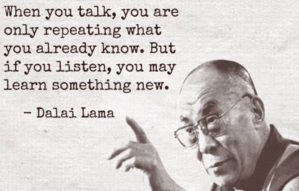-
Par gervanne le 21 Septembre 2014 à 09:45
Cet article a été publié en février 2014 par LE CRESTOIS.
 "Nous l'écrivons souvent: le diable est dans le détail. L'étalement de nos communes par de grandes zones de pavillons pose de sérieux problème. C'est d'abord une formule très spécifiquement française qui dévore du terrain alors que, dans une région agricole, il y a une solide compétition pour l'usage des terres. Par ailleurs, les communes ont des frais importants de voirie liés à l'extension de leur territoire urbanisé. Enfin, de sérieuses incertitudes existent sur l'état de ces bâtiments dans vingt ou trente ans et, par conséquent, sur leur valeur réelle à ce moment là. Le problème est que tout pousse à ce type d'évolution. L'architecte crestois David Trojanowski en témoigne.
"Nous l'écrivons souvent: le diable est dans le détail. L'étalement de nos communes par de grandes zones de pavillons pose de sérieux problème. C'est d'abord une formule très spécifiquement française qui dévore du terrain alors que, dans une région agricole, il y a une solide compétition pour l'usage des terres. Par ailleurs, les communes ont des frais importants de voirie liés à l'extension de leur territoire urbanisé. Enfin, de sérieuses incertitudes existent sur l'état de ces bâtiments dans vingt ou trente ans et, par conséquent, sur leur valeur réelle à ce moment là. Le problème est que tout pousse à ce type d'évolution. L'architecte crestois David Trojanowski en témoigne.
Le Crestois.- Est-ce que le fait que tout notre matériel électro-ménager (les machines à laver, etc), tous les éléments de construction (les portes, les fenêtres) soient de dimensions totalement standardisées ne contribue pas à nous faire vivre dans des maisons ou des appartements qui sont des petites boîtes, toutes les mêmes? David Trojanowski.-... ce que l’architecte Le Corbusier appelait des “machines à habiter”. Il est très dommage que ce mode de penser, de concevoir et de construire qu’est la standardisation amène de plus en plus à faire de certains entrepreneurs du bâtiment des «poseurs» d’un «produit» standardisé qui leur échappe, au lieu d’être des bâtisseurs ayant une technique réfléchie adaptée et adaptable au chantier en question. Le principal défaut de la standardisation est qu’elle écarte la réflexion, parfois au dépens du coût final, parfois au mépris des savoir faire... et au profit des vendeurs. Lorsqu’il y a plus de matière grise, il y a moins de matière coûteuse en définitive. Nous sommes face à l'incohérence d’un système. Il est objectivement beaucoup plus compliqué de rénover de l'ancien que de construire du neuf. Les formalités sont très lourdes. Les prêts plus difficiles à obtenir. Donc, les gens préfèrent construire des petites villas dont pourtant le principe est abandonné chez tous nos voisins et qui vont à l'encontre des buts officiellement recherchés. Prenons l'exemple de l'isolation. Il est évident que deux maisons avec des murs communs sont mieux isolées qu'une villa avec tout autour quelques mètres d'un bout de terrain. Même du point de vue de la protection de l'intimité à laquelle aspirent ceux qui construisent des villas, l'objectif n'est souvent pas atteint parce que les différentes maisons se regardent. Elles sont posées n'importe comment. Malheureusement en France nous ne savons pas faire du collectif qui préserverait l'intimité. Tous nos voisins savent parfaitement le faire mais la domination chez nous de grands groupes de la maison individuelle nous en empêche.
David Trojanowski.-... ce que l’architecte Le Corbusier appelait des “machines à habiter”. Il est très dommage que ce mode de penser, de concevoir et de construire qu’est la standardisation amène de plus en plus à faire de certains entrepreneurs du bâtiment des «poseurs» d’un «produit» standardisé qui leur échappe, au lieu d’être des bâtisseurs ayant une technique réfléchie adaptée et adaptable au chantier en question. Le principal défaut de la standardisation est qu’elle écarte la réflexion, parfois au dépens du coût final, parfois au mépris des savoir faire... et au profit des vendeurs. Lorsqu’il y a plus de matière grise, il y a moins de matière coûteuse en définitive. Nous sommes face à l'incohérence d’un système. Il est objectivement beaucoup plus compliqué de rénover de l'ancien que de construire du neuf. Les formalités sont très lourdes. Les prêts plus difficiles à obtenir. Donc, les gens préfèrent construire des petites villas dont pourtant le principe est abandonné chez tous nos voisins et qui vont à l'encontre des buts officiellement recherchés. Prenons l'exemple de l'isolation. Il est évident que deux maisons avec des murs communs sont mieux isolées qu'une villa avec tout autour quelques mètres d'un bout de terrain. Même du point de vue de la protection de l'intimité à laquelle aspirent ceux qui construisent des villas, l'objectif n'est souvent pas atteint parce que les différentes maisons se regardent. Elles sont posées n'importe comment. Malheureusement en France nous ne savons pas faire du collectif qui préserverait l'intimité. Tous nos voisins savent parfaitement le faire mais la domination chez nous de grands groupes de la maison individuelle nous en empêche.
L.C.- Mais qu'est-ce qui coûte le plus cher?
D.T.- Là vous avez raison sur la standardisation. Un exemple: les plafonds, dans la construction standard, sont à 2,50 m, dans l'ancien ça varie. Les vendeurs malins ont sû imposer une standardisation des dimensions de ces plaques. Donc, c'est un peu plus compliqué de les utiliser dans de l'ancien. Dès qu'un matériau aussi standardisé, est utilisé autrement dans certaines rénovations, c'est parfois au mépris de la qualité, et souvent assez coûteux au final. Et puis, le placoplâtre, ça ne se répare jamais. De même pour les volets roulants.
Pour ces raisons de complexité, rénover l'ancien est relativement plus cher. Il n'en reste pas moins que beaucoup de jeunes couples s'endettent horriblement pour acheter des villas..Il est triste de penser qu'elles sont réalisées avec des produits si standardisés que, quand il faudra les rafraichir, la refection sera compliquée et coûteuse... Voire impossible parfois, ça obligera à tout changer! Ce qui ne va ni dans le sens de l'économie pour les propriétaires, ni dans le sens de l'écologie...pour la planète.
Moyennant quoi les biens des acquéreurs peuvent bien à long terme peut perdre de la valeur. Certains utilisent la formule de “bombe à retardement” pour qualifier la situation qui se crée. On va se trouver dans une trentaine d'années avec des biens très dégradés où les travaux nécessaires n'auront pas pu être financés. Cela aussi parce qu'à présent on construit pour des échéances beaucoup plus courtes qu'autrefois, vingt ans à peine plus. Ce qui compte pour beaucoup de constructeurs, c’est la garantie décennale, après...
L.C.- Mais est-ce qu'il n'y a pas une orientation politique qui encourage la réhabilitation?
D.T.- Il y a ce que l'on dit et il y a ce que l'on fait. L'administration fait objectivement une politique divergente du discours officiel. Deux exemples: j'avais récemment un client qui se proposait de doubler sa demeure par l'extérieur ce qui, en matière d'isolation, est absolument conforme à la politique officielle. L'administration a refusé au motif qu'on se trouvait dans un périmètre historique alors que, par nature, c'était un aménagement invisible. A Crest, il y a quelques années, il était autorisé de faire des terrasses tropéziennes, ces aménagement sur le toît ou dans les combles qui permettent d'avoir un lieu de détente à défaut de pouvoir, dans des maisons de ville ou de bourg, avoir une vue en face intéressante. Étant donné le nombre de maisons de ce genre que nous avons dans la région et le réel problème d'aménagement que ça pose, c'est une excellente formule. Eh bien désormais c'est très difficile. C'est inexplicable.
Ajoutez à celà que la complexité des rénovations fait que certains héritiers, recevant un petit immeuble ancien préfèrent ne rien y faire et spéculer sur une hausse du foncier qui leur permettra de bien vendre dans quelques années.
L.C.- Donc il y a un solide problème de droit...
D.T.- La législation est compliquée. Elle est ballottée au gré des lobbies qui obtiennent chacun son petit avantage. Et surtout elle n'est pas stable. Exemple: il y a peu on poussait à l'utilisation de panneaux solaires. Puis on a fait marche arrière. C'est absolument impossible pour des entreprises de se lancer sur des marchés qui se referment au bout de quelques années. Résultat: on pouvait récemment se fournir chez un producteur de Bourgoin-Jallieu en panneaux solaires. L'état encourageait par des accompagnements financiers clairs, l'utilisation de panneaux solaires. Puis on a fait marche arrière...."
Mais la filière locale a été tellement déstabilisée par ces aller-et-retour, qu'il était devenu plus simple de les commander via l'allemagne...": on se tire des balles dans le pied."
 EN PUBLIANT CE TEXTE, J'OFFRE GRATUITEMENT UN ÉLÉMENT DES ARCHIVES DU CRESTOIS. MAINTENONS DANS NOTRE RÉGION UN JOURNAL INDÉPENDANT QUI NOUS SOUTIENT.
EN PUBLIANT CE TEXTE, J'OFFRE GRATUITEMENT UN ÉLÉMENT DES ARCHIVES DU CRESTOIS. MAINTENONS DANS NOTRE RÉGION UN JOURNAL INDÉPENDANT QUI NOUS SOUTIENT. votre commentaire
votre commentaire
-
Par gervanne le 19 Septembre 2014 à 14:52
 En ces temps où l'on ne pense visiblement qu'à la future campagne pour les élections présidentielles, il est juste de rappeler un des habitants de notre région qui fut candidat: Marcel Barbu, engagé dans la compétition en 1965 et dont le général de Gaulle triompha aisément puisque le « brave couillon », comme disait le général, n'aura que 1,15% des voix.
En ces temps où l'on ne pense visiblement qu'à la future campagne pour les élections présidentielles, il est juste de rappeler un des habitants de notre région qui fut candidat: Marcel Barbu, engagé dans la compétition en 1965 et dont le général de Gaulle triompha aisément puisque le « brave couillon », comme disait le général, n'aura que 1,15% des voix. Si Marcel Barbu n'était pas originaire de notre région puisqu'il est né à Nanterre puis installé à Besançon, il le fut intensément. Il s'installa en effet à Combovin où se retrouvèrent autour de lui des réfractaires au STO et des juifs. Il avait à la déclaration de guerre transféré à Valence depuis Besançon son entreprise de fabrication de boîtiers de montres prospère. Elle va prendre le nom de Communauté de Travail Boimondau (Boitiers de Montres du Dauphiné). Et elle sera partiellement une couverture pour les réfractaires qui y travaillent, d'abord à Valence puis à Combovin. Si le nom est étrange, c'est que Marcel Barbu est un homme singulier, profondément marqué par des idées spiritualistes. “L’entreprise capitaliste est un centre de production. La communauté de travail est un centre de vie totale : spirituelle, intellectuelle, sociale, politique, économique, professionnelle
Si Marcel Barbu n'était pas originaire de notre région puisqu'il est né à Nanterre puis installé à Besançon, il le fut intensément. Il s'installa en effet à Combovin où se retrouvèrent autour de lui des réfractaires au STO et des juifs. Il avait à la déclaration de guerre transféré à Valence depuis Besançon son entreprise de fabrication de boîtiers de montres prospère. Elle va prendre le nom de Communauté de Travail Boimondau (Boitiers de Montres du Dauphiné). Et elle sera partiellement une couverture pour les réfractaires qui y travaillent, d'abord à Valence puis à Combovin. Si le nom est étrange, c'est que Marcel Barbu est un homme singulier, profondément marqué par des idées spiritualistes. “L’entreprise capitaliste est un centre de production. La communauté de travail est un centre de vie totale : spirituelle, intellectuelle, sociale, politique, économique, professionnelle ”, estime-t-il. C'est ainsi qu'il veut une entreprise appartenant à tous, n'ayant pas que des objectifs économiques, où l'autorité est partagée (on se croirait au Crestois). Autour de son entreprise s'amalgameront tout un ensemble d'activités sociales (garderies, etc...)
”, estime-t-il. C'est ainsi qu'il veut une entreprise appartenant à tous, n'ayant pas que des objectifs économiques, où l'autorité est partagée (on se croirait au Crestois). Autour de son entreprise s'amalgameront tout un ensemble d'activités sociales (garderies, etc...) DEPORTE.- Très engagé dans la résistance, il sera arrêté deux fois, une fois à Paris ce qui lui vaudra de faire de la prison, puis, rapidement relâché, il vient s'installer à Combovin, dans une ferme où il développe ses idées Mais les Allemands finiront par l'investir et la détruire. Ils le déporteront.
DEPORTE.- Très engagé dans la résistance, il sera arrêté deux fois, une fois à Paris ce qui lui vaudra de faire de la prison, puis, rapidement relâché, il vient s'installer à Combovin, dans une ferme où il développe ses idées Mais les Allemands finiront par l'investir et la détruire. Ils le déporteront.Devenu député de la Drôme après guerre, parce qu'il était suppléant d'un élu qui avait choisi de démissionner, il défendra devant l'assemblée l'idée des communautés de travail à l'image de celle de Boimondau. Ces idées, teintées de christianisme social, laisseront les autres parlementaires de marbre. Dans l'intervalle, son bras droit, ou plutôt son bras gauche Marcel Mermoz proche du parti communiste s'éloigne de lui. Au demeurant, la fabrication de boîtiers de montres à Valence durera jusqu'en 1971. Lui retournera, dans la région parisienne à une autre forme de combat: celui du logement social.
Marcel Barbu va retrouver son heure de gloire lors de l'élection présidentielle de 1965 et en particulier lors d'une intervention télévisée dans le cadre de la campagne officielle où il est pris d'un sanglot. Il vient alors de dire: « Je ne suis le cheval de retour d'aucune république, moi. Je ne suis que le Français moyen avec lequel vous avez combattu dans la Grande guerre, sauvé l'honneur du pays en 1940 (...) Le peuple a cru qu'il allait être aimé et vous avez déçu ce rêve. (…) Ce serait un grand malheur pour la France et les Français de vous voir revivre la fin du maréchal Pétain, nous n'en sommes pas encore remis ».
Voici ce qu'écrit François Caviglioli dans Combat après ce mémorable passage à la télévision. « M. Marcel Barbu porte sur le devant de la scène politique le grand combat contre les « Ils ». Les « Ils » sont partout. Ils empruntent les déguisement les plus divers. Ils vous suivent dans la rue, lisent votre courrier. Ils rudoient l'employé de mairie, la concierge, le contractuel, le receveur d'autobus. (…) Ils sont très habiles. Ils vous cernent, vous oppressent. Ils font disparaître votre poubelle, ils persuadent les chiens d'aller souiller votre paillasson (…) Mais M. Marcel Barbu est là pour vous défendre (…) Le Grand Parti des Persécutés va s'unir. La Constitution de la V° République a ouvert les profondeurs psychiatriques de la France ».
Un habillage en règle comme on peut voir. Bien d'autres journaux seront aussi cruels et Marcel Barbu quitterai la scène politique à la même vitesse qu'il l'avait investi. Mais ses idées de communauté de travail ont continué à avoir assez longtemps des adeptes. Marcel Barbu est mort en 1984.

 EN PUBLIANT CE TEXTE, J'OFFRE GRATUITEMENT UN ÉLÉMENT DES ARCHIVES DU CRESTOIS. MAINTENONS DANS NOTRE RÉGION UN JOURNAL INDÉPENDANT QUI NOUS SOUTIENT.
EN PUBLIANT CE TEXTE, J'OFFRE GRATUITEMENT UN ÉLÉMENT DES ARCHIVES DU CRESTOIS. MAINTENONS DANS NOTRE RÉGION UN JOURNAL INDÉPENDANT QUI NOUS SOUTIENT. 1 commentaire
1 commentaire
-
Par gervanne le 17 Septembre 2014 à 16:00
André Happel a disparu début 2013. En 2010, Le Crestois lui avait consacré l'article que voici.
 "En principe, cet article n'aurait jamais du paraître. C'était clair entre André
"En principe, cet article n'aurait jamais du paraître. C'était clair entre André  Happel et moi: ses expériences de récit de son activité, entre 1959 et 1965, comme aumônier dans la prison militaire interalliée de Spandau en Allemagne où étaient détenus quelques dignitaires nazis, dans les colonnes de confrères l'avaient dégoûté. Il se défiait d'un soupçon toujours possible qu'il veuille se mettre en avant par une circonstance dans laquelle l'Histoire l'a plongé. Il y a une densité des événements, une horreur de la guerre qui ont des effets colatéraux, même pour ceux qui ne sont qu'en simple position d'observateur.
Happel et moi: ses expériences de récit de son activité, entre 1959 et 1965, comme aumônier dans la prison militaire interalliée de Spandau en Allemagne où étaient détenus quelques dignitaires nazis, dans les colonnes de confrères l'avaient dégoûté. Il se défiait d'un soupçon toujours possible qu'il veuille se mettre en avant par une circonstance dans laquelle l'Histoire l'a plongé. Il y a une densité des événements, une horreur de la guerre qui ont des effets colatéraux, même pour ceux qui ne sont qu'en simple position d'observateur. UN PLI.-André Happel, né en 1920, d'une famille alsacienne a une belle figure marquée par de profondes rides, une allure qui ferait penser à un ministre de la IV° République ou à un professeur à la Sorbonne (de théologie, de préférence). Il est depuis peu d'années installé à Crest auprès de ses enfants. C'est un caractère fort, son élocution, la certitude de ses affirmations, son regard, le disent. Il parle d'abondance mais il n'est pas bavard: il faut que cela sorte. Cette expérience unique de rencontre avec des hommes totalement hors la norme, Albert Speer, l'architecte favori d'Hitler qui remodela Berlin, Rudolf Hess, le dauphin du Führer et Baldur von Schirach, le chef des Jeunesses Hitlériennes, est comme une charge qu'il doit partager. Pas pour qu'on l'écrive – Oh, que non- mais parce que cela marqua sa vie d'un pli qui reste et qu'on aura beau dire, beau faire, il sera là. Il regarde avec humeur le journaliste qui prend des notes et ne manque pas de lui signaler qu'il n'a encore donné aucun accord pour publication. Mais à peine est-ce dit qu'un souvenir revient. Et bientôt se forge chez l'interlocuteur le sentiment que ce n'est ni de Rudolf Hess, ni de Albert Speer qu'il faut parler, mais de la transmission de souvenirs aussi lourds, des relations qui peuvent s'établir entre des hommes avec des passés aussi accablants. Et même de l'étrange possibilité que naissent des sentiments banals, ceux de la vie quotidienne, avec des êtres dont on a l'impression qu'ils ne peuvent être que des monstres. Oui, il est des rencontres dont on ne sort jamais indemne. C'est de cela que peut témoigner André Happel. De ce silence de Rudolf Hess qui parlait si peu, qui se refermait sur lui-même, ne s'évadant que dans la musique. De cette affabilité et de cette grande culture d'Albert Speer qui rêvait de voir des sites architecturaux grecs. De cette pusillanimité de Baldur von Schirach, intéressé par ses belles bottes, mais guère par les livres.
UN PLI.-André Happel, né en 1920, d'une famille alsacienne a une belle figure marquée par de profondes rides, une allure qui ferait penser à un ministre de la IV° République ou à un professeur à la Sorbonne (de théologie, de préférence). Il est depuis peu d'années installé à Crest auprès de ses enfants. C'est un caractère fort, son élocution, la certitude de ses affirmations, son regard, le disent. Il parle d'abondance mais il n'est pas bavard: il faut que cela sorte. Cette expérience unique de rencontre avec des hommes totalement hors la norme, Albert Speer, l'architecte favori d'Hitler qui remodela Berlin, Rudolf Hess, le dauphin du Führer et Baldur von Schirach, le chef des Jeunesses Hitlériennes, est comme une charge qu'il doit partager. Pas pour qu'on l'écrive – Oh, que non- mais parce que cela marqua sa vie d'un pli qui reste et qu'on aura beau dire, beau faire, il sera là. Il regarde avec humeur le journaliste qui prend des notes et ne manque pas de lui signaler qu'il n'a encore donné aucun accord pour publication. Mais à peine est-ce dit qu'un souvenir revient. Et bientôt se forge chez l'interlocuteur le sentiment que ce n'est ni de Rudolf Hess, ni de Albert Speer qu'il faut parler, mais de la transmission de souvenirs aussi lourds, des relations qui peuvent s'établir entre des hommes avec des passés aussi accablants. Et même de l'étrange possibilité que naissent des sentiments banals, ceux de la vie quotidienne, avec des êtres dont on a l'impression qu'ils ne peuvent être que des monstres. Oui, il est des rencontres dont on ne sort jamais indemne. C'est de cela que peut témoigner André Happel. De ce silence de Rudolf Hess qui parlait si peu, qui se refermait sur lui-même, ne s'évadant que dans la musique. De cette affabilité et de cette grande culture d'Albert Speer qui rêvait de voir des sites architecturaux grecs. De cette pusillanimité de Baldur von Schirach, intéressé par ses belles bottes, mais guère par les livres. LA BATAILLE DE LANG SON.- Et pourtant André Happel pourrait convoquer bien d'autres souvenirs. Il fut, dès les débuts de son ministère, confronté à des situations d'exception. Après une brève expérience de pasteur en Lorraine, il part en Indochine. Il est nommé à Saïgon auprès de six hôpitaux: « Je passais mon temps auprès des mourants », raconte-t-il. Le pire est à venir. Il est en effet aumônier militaire en 1950, lors de la bataille de Lang Son où les soldats de la Légion Etrangère tombent comme des mouches face à l'offensive chinoise. Puis, Il sera longuement, par la suite, en poste à Meknès puis à Rabat avant de rejoindre la Suisse. Il n'y est plus alors que comme simple pasteur. Il se souvient, détail pittoresque, d'avoir été amené, lui le Français, a prononcer des discours patriotiques suisses, dans le cadre de son activité dans le canton de Vaud.
LA BATAILLE DE LANG SON.- Et pourtant André Happel pourrait convoquer bien d'autres souvenirs. Il fut, dès les débuts de son ministère, confronté à des situations d'exception. Après une brève expérience de pasteur en Lorraine, il part en Indochine. Il est nommé à Saïgon auprès de six hôpitaux: « Je passais mon temps auprès des mourants », raconte-t-il. Le pire est à venir. Il est en effet aumônier militaire en 1950, lors de la bataille de Lang Son où les soldats de la Légion Etrangère tombent comme des mouches face à l'offensive chinoise. Puis, Il sera longuement, par la suite, en poste à Meknès puis à Rabat avant de rejoindre la Suisse. Il n'y est plus alors que comme simple pasteur. Il se souvient, détail pittoresque, d'avoir été amené, lui le Français, a prononcer des discours patriotiques suisses, dans le cadre de son activité dans le canton de Vaud. RUDOLF HESS SUICIDÉ?.-C'est donc après ces étapes que, de 1959 à 1965, il est nommé à Berlin auprès de ces hommes hors la norme, dans un cadre qui, lui-même, était surréaliste: une prison immense, prévue dès 1890 par l'Empereur Guillaume II pour 600 personnes, mais où ne se trouvaient qu'une poignée d'hommes, au terme d'expériences exceptionnelles même si c'est dans le registre du sinistre. Tout cela dans une fonction sans précédent: on n'apprend nulle part a être à l'écoute de dirigeants nazis. Rien à voir avec l'habituel catéchisme, ni même avec la relation, comme pasteur, avec un voleur ordinaire. Il fallait tout inventer pour se situer auprès de ces hommes . Hess indifférent, les autres reprenant lentement conscience qu'existait un autre monde que l'univers fou auquel ils avaient appartenu. Tout cela se déroulait sous le regard d'une administration qui avait pour mission qu'on oublie ces hommes, qu'on n'en parle le moins possible. Tout le monde les avait-il oublié? André Happel est convaincu qu'on a suicidé Rudolf Hess, censé s'être donné la mort le 17 août 1987 à Spandau. « Il luttait pour essayer de s'y retrouver, raconte André Happel. S'est-il converti, comme on l'a prétendu? Qui peut le dire? » Ses camarades de détention avaient quitté les lieux après avoir purgé leur peine, Albert Speer s'offrant même le luxe de mener sur la fin une vie mondaine. Il mourra à Londres... dans les bras d'une maîtresse.
RUDOLF HESS SUICIDÉ?.-C'est donc après ces étapes que, de 1959 à 1965, il est nommé à Berlin auprès de ces hommes hors la norme, dans un cadre qui, lui-même, était surréaliste: une prison immense, prévue dès 1890 par l'Empereur Guillaume II pour 600 personnes, mais où ne se trouvaient qu'une poignée d'hommes, au terme d'expériences exceptionnelles même si c'est dans le registre du sinistre. Tout cela dans une fonction sans précédent: on n'apprend nulle part a être à l'écoute de dirigeants nazis. Rien à voir avec l'habituel catéchisme, ni même avec la relation, comme pasteur, avec un voleur ordinaire. Il fallait tout inventer pour se situer auprès de ces hommes . Hess indifférent, les autres reprenant lentement conscience qu'existait un autre monde que l'univers fou auquel ils avaient appartenu. Tout cela se déroulait sous le regard d'une administration qui avait pour mission qu'on oublie ces hommes, qu'on n'en parle le moins possible. Tout le monde les avait-il oublié? André Happel est convaincu qu'on a suicidé Rudolf Hess, censé s'être donné la mort le 17 août 1987 à Spandau. « Il luttait pour essayer de s'y retrouver, raconte André Happel. S'est-il converti, comme on l'a prétendu? Qui peut le dire? » Ses camarades de détention avaient quitté les lieux après avoir purgé leur peine, Albert Speer s'offrant même le luxe de mener sur la fin une vie mondaine. Il mourra à Londres... dans les bras d'une maîtresse. INTENSE.-Tous ont disparu aujourd'hui mais leur souvenir continue d'occuper la mémoire d'André Happel. Autant pour les faire revivre que pour s'interroger sur lui-même, sur cette confrontation hors la norme qu'il a vécue, dont il craint qu'on ne la lui reproche et qui fut si intense. Car il y a cette expérience elle-même et puis l'accueil qui lui fût faite: la difficulté sinon à la raconter, du moins à la faire accepter. Est-on complice lorsqu'on est aumônier de grands criminels? Non, bien sûr. Pourtant, il n'est pas sûr que ce soit le regard commun. Et dès lors, le poids du souvenir s'alourdit.
INTENSE.-Tous ont disparu aujourd'hui mais leur souvenir continue d'occuper la mémoire d'André Happel. Autant pour les faire revivre que pour s'interroger sur lui-même, sur cette confrontation hors la norme qu'il a vécue, dont il craint qu'on ne la lui reproche et qui fut si intense. Car il y a cette expérience elle-même et puis l'accueil qui lui fût faite: la difficulté sinon à la raconter, du moins à la faire accepter. Est-on complice lorsqu'on est aumônier de grands criminels? Non, bien sûr. Pourtant, il n'est pas sûr que ce soit le regard commun. Et dès lors, le poids du souvenir s'alourdit.Et si ces lignes paraissent, c'est qu'André Happel, après réflexion, a donné son accord. Car l'important est, en effet, qu'on puisse mesurer la trace, la complexité de pareilles rencontres. « A partir d'un certain degré d'intensité, ce qu'on vit est intransmissible », dit André Happel. C'est tout le problème."
PS.
Les Sept de Spandau
Un livre a été écrit autour de l'expériences des différents aumôniers de la prison de Spandau où se trouvaient les criminels de guerre nazis majeurs emprisonnés après les décisions du tribunal de Nuremberg. Il s'intitule « Les Sept de Spandau, les secrets révélés des derniers criminels de guerre nazis ». Il est signé de Laure Joanin-Liobet. Il est paru chez Oh! Editions en 2008.

 EN PUBLIANT CE TEXTE, J'OFFRE GRATUITEMENT UN ÉLÉMENT DES ARCHIVES DU CRESTOIS. MAINTENONS DANS NOTRE RÉGION UN JOURNAL INDÉPENDANT QUI NOUS SOUTIENT.
EN PUBLIANT CE TEXTE, J'OFFRE GRATUITEMENT UN ÉLÉMENT DES ARCHIVES DU CRESTOIS. MAINTENONS DANS NOTRE RÉGION UN JOURNAL INDÉPENDANT QUI NOUS SOUTIENT. votre commentaire
votre commentaire
-
Par gervanne le 15 Septembre 2014 à 09:01
 Chez nous, on parle du Val de Drôme. Appellation trompeuse. Montez donc sous les a pics des Trois Becs ou de Couspeau. Là, de “val” il n'est plus question. Voici par exemple La Chaudière, qui est un de nos villages les plus isolés, sous les Trois Becs. Elle eût la rude existence de ces localités qui n'intéressaient pas grand monde. On dit que les Maures l'auraient pillé en 731. Mais quand même! Le pape en personne – Urbain II exactement- savait qu'elle existait puisqu'on a une lettre de lui de 1005 où il mentionne une église “Ecclesia Calcium in Diensi”. En 1145, la localité jusque là propriété des comtes de Valentinois passe aux évèques de Die. En 1577, les guerres de religions y font rage puisqu'il faut pas de 24 porteurs pour évacuer les blessés vers Saillans, puis Beaufort. En 1639, on en trouve mention sous l'orthographe sous la forme La Chodière. En 1793, saisie apparemment d'ardeurs révolutionnaires, elle a sa “Société Populaire”. On mesure l'incroyable écart de peuplement entre aujourd'hui (25 habitants) et l'époque (143 en 1832) ce qui montre combien on pouvait alors accepter des existences rudes. En 1848, la Vierge apparaît au lieu dit Les Sadoux, du nom d'une famille ainsi nommée, qui vont devenir le lieu d'un pèlerinage. Le problème est que l'ardeur à cette dévotion va se perdre. On raconte qu'un vieux garçon d'une famille Brun eût l'idée pour le relancer d'aller chercher des cerises qu'il mit dans des chênes et fit circuler le bruit qu'un nouveau miracle avait lieu: des cerises poussaient dans des chênes. C'était son truc à lui
Chez nous, on parle du Val de Drôme. Appellation trompeuse. Montez donc sous les a pics des Trois Becs ou de Couspeau. Là, de “val” il n'est plus question. Voici par exemple La Chaudière, qui est un de nos villages les plus isolés, sous les Trois Becs. Elle eût la rude existence de ces localités qui n'intéressaient pas grand monde. On dit que les Maures l'auraient pillé en 731. Mais quand même! Le pape en personne – Urbain II exactement- savait qu'elle existait puisqu'on a une lettre de lui de 1005 où il mentionne une église “Ecclesia Calcium in Diensi”. En 1145, la localité jusque là propriété des comtes de Valentinois passe aux évèques de Die. En 1577, les guerres de religions y font rage puisqu'il faut pas de 24 porteurs pour évacuer les blessés vers Saillans, puis Beaufort. En 1639, on en trouve mention sous l'orthographe sous la forme La Chodière. En 1793, saisie apparemment d'ardeurs révolutionnaires, elle a sa “Société Populaire”. On mesure l'incroyable écart de peuplement entre aujourd'hui (25 habitants) et l'époque (143 en 1832) ce qui montre combien on pouvait alors accepter des existences rudes. En 1848, la Vierge apparaît au lieu dit Les Sadoux, du nom d'une famille ainsi nommée, qui vont devenir le lieu d'un pèlerinage. Le problème est que l'ardeur à cette dévotion va se perdre. On raconte qu'un vieux garçon d'une famille Brun eût l'idée pour le relancer d'aller chercher des cerises qu'il mit dans des chênes et fit circuler le bruit qu'un nouveau miracle avait lieu: des cerises poussaient dans des chênes. C'était son truc à lui  pour relancer le pèlerinage. Il a fallu attendre 1956 pour que le village soit électrifié et l'ancien maire Raymond Patonnier (photo et ci-dessous avec ses boeufs)), lui, n'eût l'eau au robinet qu'en 1981. Il est le fils de Henri Augustin Patonnier, propriétaire des 150 hectares qui se trouvent juste de l'autre côté du col de La Chaudière lorsqu'on bascule sur Bézaudun-sur-Bîne. Partout là autour la pente est terrible. Longtemps on ne put que faire travailler des boeufs en raison de la déclivité des terres. Raymond Patonnier raconte que le problème des tracteurs lorsqu'on faisait les foins était que le foin pouvait se coller sous les roues du tracteur et finalement celui-ci partir en luge dans la pente.
pour relancer le pèlerinage. Il a fallu attendre 1956 pour que le village soit électrifié et l'ancien maire Raymond Patonnier (photo et ci-dessous avec ses boeufs)), lui, n'eût l'eau au robinet qu'en 1981. Il est le fils de Henri Augustin Patonnier, propriétaire des 150 hectares qui se trouvent juste de l'autre côté du col de La Chaudière lorsqu'on bascule sur Bézaudun-sur-Bîne. Partout là autour la pente est terrible. Longtemps on ne put que faire travailler des boeufs en raison de la déclivité des terres. Raymond Patonnier raconte que le problème des tracteurs lorsqu'on faisait les foins était que le foin pouvait se coller sous les roues du tracteur et finalement celui-ci partir en luge dans la pente. Dans ce pays, il n'était pas facile de se marier. Une anecdote avait été recueillie en 2001 par une petite équipe soucieuse d'histoire locale – l'association Signal Culture- auprès de M. Paul Garzini. Il avait alors raconté comment au hameau des Hoirs, se trouvait une famille fort bien, les Gleize, qui avaient six filles. A quelques distances de là, au village de Savel, se trouvaient les Mège qui étaient toujours en train de bouger, raison pour laquelle on les avaient appelé les Crépitous. Et parmi eux, un gars haut comme trois pommes, il mesurait 1, 55m. Le propre grand père de M. Garzini, colporteur de son état, avait été sollicité, par M. Mège père pour qu'il trouve une femme à ce fils là. C'était un assez bon parti: plus de deux cents brebis, sans compter les noix et les truffes. “Mais c'est bien facile dit le colporteur en patois. Prends la Courance à la remonta, va chez les Gleize. Des femmes, il y en a six.” Ce que fit donc le père le dimanche suivant. Il prit deux musettes, l'une pour mettre sa veste et un peu de “biasse” pour manger, dans l'autre deux bouteilles de bon vin pour boire. Et le voilà qui monte, qui passe le hameau des Gl
Dans ce pays, il n'était pas facile de se marier. Une anecdote avait été recueillie en 2001 par une petite équipe soucieuse d'histoire locale – l'association Signal Culture- auprès de M. Paul Garzini. Il avait alors raconté comment au hameau des Hoirs, se trouvait une famille fort bien, les Gleize, qui avaient six filles. A quelques distances de là, au village de Savel, se trouvaient les Mège qui étaient toujours en train de bouger, raison pour laquelle on les avaient appelé les Crépitous. Et parmi eux, un gars haut comme trois pommes, il mesurait 1, 55m. Le propre grand père de M. Garzini, colporteur de son état, avait été sollicité, par M. Mège père pour qu'il trouve une femme à ce fils là. C'était un assez bon parti: plus de deux cents brebis, sans compter les noix et les truffes. “Mais c'est bien facile dit le colporteur en patois. Prends la Courance à la remonta, va chez les Gleize. Des femmes, il y en a six.” Ce que fit donc le père le dimanche suivant. Il prit deux musettes, l'une pour mettre sa veste et un peu de “biasse” pour manger, dans l'autre deux bouteilles de bon vin pour boire. Et le voilà qui monte, qui passe le hameau des Gl eyzolles, franchit le col de la mort, et remonte la vallée de la Courance et arrive chez les Gleize.
eyzolles, franchit le col de la mort, et remonte la vallée de la Courance et arrive chez les Gleize.-
Mais quel bon vent t'as vu Crépitou, lui dit le père Mège qui l'attend sous le calabert (l'auvent).
-
C'est Garcin, le colporteur, qui m'a dit que tu avais des filles à marier.
-
Il y en a six. Entre donc.
-
Non, non, j'attends là. Fais les sortir.
Comme bien l'on pense, c'est ce qui se passa et le père Mège choisit celle qui mesurait 1,85m. Plus tard, lorsqu'on lui demanda pourquoi il avait choisi celle-là, il expliqua: “Je l'ai choisie si grande pour faire les meules de foin”. C'est qu'en effet, le fiston avec son mètre cinquante cinq était un peu embarrassé. Jusqu'à la fin de la guerre, il eût par exemple une énorme Citroën B 14, aux allures de paquebot. Il lui fallait monter sur un jerrycan mis sur son siège pour voir la route. C'était un audacieux. Comme la Roanne, en face de chez lui pouvait devenir grosse l'hiver, il avait tendu au travers de son cours deux câbles, l'un à hauteur de ses pieds l'autre, à hauteur de ses bras. Comme cela, l'hiver harnaché de trois musettes, il pouvait la franchir en marchant sur le câble. Dans la première musette, il mettait son chien, dans la deuxième de quoi manger, la troisième était prévue pour les truffes qu'il ramasserait.
 On est là dans ces pays de notre région où tout est conditionné par les hauteurs, leur rudesse, leurs colères. Un peu plus loin – oh pas très loin à vol d'oiseau, mais si loin en voiture- se trouve Couspeau, le massif jumeau des Trois Becs. Et, en dessous, ce sont les Tonils. Là vit l'ancien berger Bruno Palayer. Tout le monde, dans le pays sait qu'il eût un grand malheur en cette terrible journée de 1981 où, par la faute de deux chiens errants, pas moins de 300 de ses moutons – vous avez bien lu- furent tués dans sa bergerie, non pas que les chiens les aient tous attaqués mais plutôt que la panique qu'ils provoquèrent, les jeta les uns sur les autres. Ils furent ainsi étouffés.
On est là dans ces pays de notre région où tout est conditionné par les hauteurs, leur rudesse, leurs colères. Un peu plus loin – oh pas très loin à vol d'oiseau, mais si loin en voiture- se trouve Couspeau, le massif jumeau des Trois Becs. Et, en dessous, ce sont les Tonils. Là vit l'ancien berger Bruno Palayer. Tout le monde, dans le pays sait qu'il eût un grand malheur en cette terrible journée de 1981 où, par la faute de deux chiens errants, pas moins de 300 de ses moutons – vous avez bien lu- furent tués dans sa bergerie, non pas que les chiens les aient tous attaqués mais plutôt que la panique qu'ils provoquèrent, les jeta les uns sur les autres. Ils furent ainsi étouffés. Dire que Bruno Palayer (en photo avec sa femme) a aimé ses bêtes, c'est bien trop peu dire. Il les a adorées, il les a étudiées, il en a perfectionné la race, ayant choisi, contrairement aux coutumes locale, d'implanter chez nous des mérinos, connus pour leur laine fine.
Dire que Bruno Palayer (en photo avec sa femme) a aimé ses bêtes, c'est bien trop peu dire. Il les a adorées, il les a étudiées, il en a perfectionné la race, ayant choisi, contrairement aux coutumes locale, d'implanter chez nous des mérinos, connus pour leur laine fine.Il s'est battu et plus qu'un peu car il y eût dans cette affaire une vilenie qui aboutit à le dessaisir, en 1992, de « sa » montagne, comme il dit tout le temps, le Couspeau, cet immense domaine de plusieurs centaines d'hectares qu'il avait constitué pièce à pièce, achetant ici, louant là. Il faudrait être Jean Giono, Henri Bosco ou André Chamson pour savoir bien raconter ce petit complot de campagne où se trouvèrent mêlées banques, élus, administrations, hommes de loi plus ou moins honorables. Vingt ans sont passés. Par un plaisant clin d'oeil du destin certains qui s'étaient prêtés à cette opération peu glorieuse ont fini par faire de mauvaises affaires, d'autres sont morts. Laissons les à leur sommeil éternel. Mais jamais nulle part quiconque ne pourra dire qu'il est honorable de faire racheter à quelqu'un sa propre maison. A l'instant de le quitter, au moment de l'ultime poignée de mains, il lâcha: « Vous savez, nous on n'est pas des méchants, alors, des fois, les larmes viennent ».
Mais il faut oublier tout cela parce que c'est la passion de Bruno Palayer pour les moutons qui le porte encore.
 Né dans une famille de neuf enfants à Hostun, d'un père qui y tenait une carrière, Bruno Palayer a tôt voulu devenir berger, en souvenir des trois sous qu'il gagnait chez le voisin lorsqu'il lui donnait un coup de main pour la récolte du tabac. Le voici donc à Rambouillet où l'on forme des bergers mais où en cette fin des années cinquante on ne peut le prendre qu'en auditeur libre. Un matin, se présente un rude gars, Louis Piton, qui demande un stagiaire pour l'aider là, maintenant, tout de suite. Un dur le Piton. Mais aujourd'hui Bruno Palayer lui rend hommage. Et d'abord en souvenir de la promesse que lui fit alors le directeur de l'école de Rambouillet: « Si vous tenez un an avec ce gars là, ça vaudra un concours d'entrée et je vous reprends en deuxième année. » Ce qui arriva avec le bénéfice d'une fameuse expérience. « Piton, c'était un dur, mais la sensibilité n'était pas loin ». Et puis, le voici à la sortie de l'école, embauché par les frères Buna, dans la plaine de la Cros, transhumant deux mille bêtes avec eux dans le Queyras, allant saluer à l'occasion les bergers italiens. « Ah, eux c'étaient des sacrés travailleurs. Non seulement, ils gardaient les bêtes mais en plus ils fabriquaient du fromage ».
Né dans une famille de neuf enfants à Hostun, d'un père qui y tenait une carrière, Bruno Palayer a tôt voulu devenir berger, en souvenir des trois sous qu'il gagnait chez le voisin lorsqu'il lui donnait un coup de main pour la récolte du tabac. Le voici donc à Rambouillet où l'on forme des bergers mais où en cette fin des années cinquante on ne peut le prendre qu'en auditeur libre. Un matin, se présente un rude gars, Louis Piton, qui demande un stagiaire pour l'aider là, maintenant, tout de suite. Un dur le Piton. Mais aujourd'hui Bruno Palayer lui rend hommage. Et d'abord en souvenir de la promesse que lui fit alors le directeur de l'école de Rambouillet: « Si vous tenez un an avec ce gars là, ça vaudra un concours d'entrée et je vous reprends en deuxième année. » Ce qui arriva avec le bénéfice d'une fameuse expérience. « Piton, c'était un dur, mais la sensibilité n'était pas loin ». Et puis, le voici à la sortie de l'école, embauché par les frères Buna, dans la plaine de la Cros, transhumant deux mille bêtes avec eux dans le Queyras, allant saluer à l'occasion les bergers italiens. « Ah, eux c'étaient des sacrés travailleurs. Non seulement, ils gardaient les bêtes mais en plus ils fabriquaient du fromage ».Il y eût la guerre d'Algérie et puis cd jour où, au volant de sa vieille 2 CV, il passe le col de Lunel, parce qu'il a entendu parler d'une ferme à vendre. « Ah, lorsque j'ai vu Couspeau au loin, cette montagne bleue, je regardais la montagne et plus la route. J'ai tout de suite su que c'était là que je voudrais être. » Et le voilà qui s'installe dans une ferme en mauvais état qui loue ici, passe des accords là, achète encore et aujourd'hui encore lorsqu'on regarde depuis le sommet de Couspeau l'immensité du domaine aride qu'il tailla à ses bêtes, on en reste un peu soufflé. Il eût là 830 hectares.
 Mais ce sont les bêtes qui sont ici importantes. Il faut voir comment s'illumine son visage lorsqu'il raconte comment il préféra les mérinos, plus légers dans les rudes pentes du Couspeau que la traditionnelle race des Préalpes du Sud. « Mais j'ai fait un croisement pour que mes bêtes aient des qualités adaptées à la configuration de ces pâturages en particulier ». Il faut l'entendre parler jusque dans les moindres détails du moment où il mettait « les béliers en lutte », comme l'on dit, c'est à dire comment il organisait la reproduction. Et le voici encore qui raconte à quelles dates exactes il faisait manger ses bêtes, six cents ou sept cents à la belle époque, ici en alpage, là dans les prairies de fond de vallée. Il faut l'entendre raconter comment il improvisa une route sur laquelle il fit rouler le premier 4X4 Toyota du département. « C'est que, jusque là, je montais tout l'approvisionnement de mon berger sur le dos, deux heures de rude marche. » Rien, rien, rien n'était laissé au hasard et tel était le bonheur de Bruno Palayer. Et en dépit des avanies que nous avons dites, à l'instant de ce séparer, il dit: « Vous savez, j'ai eu une vie très belle, très rude mais très belle »
Mais ce sont les bêtes qui sont ici importantes. Il faut voir comment s'illumine son visage lorsqu'il raconte comment il préféra les mérinos, plus légers dans les rudes pentes du Couspeau que la traditionnelle race des Préalpes du Sud. « Mais j'ai fait un croisement pour que mes bêtes aient des qualités adaptées à la configuration de ces pâturages en particulier ». Il faut l'entendre parler jusque dans les moindres détails du moment où il mettait « les béliers en lutte », comme l'on dit, c'est à dire comment il organisait la reproduction. Et le voici encore qui raconte à quelles dates exactes il faisait manger ses bêtes, six cents ou sept cents à la belle époque, ici en alpage, là dans les prairies de fond de vallée. Il faut l'entendre raconter comment il improvisa une route sur laquelle il fit rouler le premier 4X4 Toyota du département. « C'est que, jusque là, je montais tout l'approvisionnement de mon berger sur le dos, deux heures de rude marche. » Rien, rien, rien n'était laissé au hasard et tel était le bonheur de Bruno Palayer. Et en dépit des avanies que nous avons dites, à l'instant de ce séparer, il dit: « Vous savez, j'ai eu une vie très belle, très rude mais très belle »
 EN PUBLIANT CE TEXTE, J'OFFRE GRATUITEMENT UN ÉLÉMENT DES ARCHIVES DU CRESTOIS. MAINTENONS DANS NOTRE RÉGION UN JOURNAL INDÉPENDANT QUI NOUS SOUTIENT.
EN PUBLIANT CE TEXTE, J'OFFRE GRATUITEMENT UN ÉLÉMENT DES ARCHIVES DU CRESTOIS. MAINTENONS DANS NOTRE RÉGION UN JOURNAL INDÉPENDANT QUI NOUS SOUTIENT. 2 commentaires
2 commentaires
-
-
Par gervanne le 12 Septembre 2014 à 23:29

 Dans mon petit village, en avril dernier, un vieil homme, 86 ans, avait préféré mettre fin à ses jours plutôt que d'aller à l'hôpital. Il s'appelait Marcel Bertonnier, avait d'abord été ce que, jadis, on appelait un "trimardeur", c'est à dire qu'il avait loué sa force physique dans des fermes un peu partout en France. Puis, il était venu s'installer comme croque-mort dans la région. Il connaissait mieux que personne les coins à champignons de la région. Surtout, il en était la mémoire en racontant avec talent toutes les histoires, y compris celles qui remontaient à l'Antiquité. Je ne suis pas sûr que notre temps de téléréalité sache soupeser le vrai poids de ce type de personnage. Pour manifester que je n'oublie pas ce beau profil, je republie ici le portrait que j'avais fait de lui, il y a quelques années. Et puis j'aime bien l'idée que des articles anciens puissent revivre.
Dans mon petit village, en avril dernier, un vieil homme, 86 ans, avait préféré mettre fin à ses jours plutôt que d'aller à l'hôpital. Il s'appelait Marcel Bertonnier, avait d'abord été ce que, jadis, on appelait un "trimardeur", c'est à dire qu'il avait loué sa force physique dans des fermes un peu partout en France. Puis, il était venu s'installer comme croque-mort dans la région. Il connaissait mieux que personne les coins à champignons de la région. Surtout, il en était la mémoire en racontant avec talent toutes les histoires, y compris celles qui remontaient à l'Antiquité. Je ne suis pas sûr que notre temps de téléréalité sache soupeser le vrai poids de ce type de personnage. Pour manifester que je n'oublie pas ce beau profil, je republie ici le portrait que j'avais fait de lui, il y a quelques années. Et puis j'aime bien l'idée que des articles anciens puissent revivre."Qu'il pleuve ou qu'il vente, vous le croiserez sur les sentiers de la Gervanne. Marcel Bertonnier, 82 ans (à l'époque) et une forme superbe, le martèle: « ma promenade quotidienne, elle est mé-di-cale. Une heure- une heure et demi, pas plus. La distance je m'en moque. Mais la durée, je m'y tiens. » Le visage est buriné et creusé par les rides, l'allure incroyablement svelte pour un homme de son âge et surtout après une vie comme la sienne. Ah, ça oui, quelle vie! Ouvrier agricole pendant trente bonnes années et fossoyeur pendant quinze ans encore. Comme tel bien sûr, il est porteur de la mémoire de nos campagnes, mais c'est aussi pour ses marottes qu'il faut l'interroger, sa passion des monnaies gauloises et romaines qu'il est allé dénicher dans tous les champs de la région avec sa « poêle à frire ». Sa passion aussi des champignons qui lui a valu de la part de notre ancien confrère du Dauphiné Libéré, Henry Combes, le titre de « meilleur chercheur de champignons de la Drôme ». Il sourit: « Oh, c'était peut-être exagéré. Vous savez bien: les journalistes ça exagère toujours... »
 REPARTIR SUR LE TRIMARD.-Marcel Bertonnier est né à Saint Péray, « un pays d'alcooliques, à cause de leur bon vin blanc ». La vie y est dure. Sa mère ramasse des champignons pour vivre, ce qui lui offrira un fort utile apprentissage. A douze ans, au début de la guerre, on l'envoie garder les vaches dans les montagnes d'Ardèche. Cela le préservera un peu de la dureté des temps, mais l'en laissera témoin tout de même: « je voyais des patriotes qui sortaient des maquis. Je me souviens d'un qui m'a fait essayer sa mitraillette qu'il venait de recevoir d'un parachutage. Des hauteurs où j'étais, j'ai pu voir la bataille autour de Valence. Je me souviens de trois forteresses volantes abattues par la flack allemande autour de la ville. »
REPARTIR SUR LE TRIMARD.-Marcel Bertonnier est né à Saint Péray, « un pays d'alcooliques, à cause de leur bon vin blanc ». La vie y est dure. Sa mère ramasse des champignons pour vivre, ce qui lui offrira un fort utile apprentissage. A douze ans, au début de la guerre, on l'envoie garder les vaches dans les montagnes d'Ardèche. Cela le préservera un peu de la dureté des temps, mais l'en laissera témoin tout de même: « je voyais des patriotes qui sortaient des maquis. Je me souviens d'un qui m'a fait essayer sa mitraillette qu'il venait de recevoir d'un parachutage. Des hauteurs où j'étais, j'ai pu voir la bataille autour de Valence. Je me souviens de trois forteresses volantes abattues par la flack allemande autour de la ville. » La paix revenue, il faut trouver un métier. Et, décidément, le goût des grands espaces acquis dans l'adolescence lui reste. Il aura bien l'occasion de se faire embaucher dans un immense consortium sidérurgique, à Rombas, à la frontière luxembourgeoise, « grand comme d'ici à Montélimar, avec des trains qui le sillonnaient ». Mais il y fait trop froid, il y a du brouillard et puis non décidément, ça n'est pas son monde! « J'ai eu un copain qui est allé se faire embaucher aux mines de Saint-Etienne. Je lui ai dit « vas-y, tu n'es pas prêt de m'y voir » ». Alors, il va de ferme en ferme, en Languedoc, en Seine et Marne, un peu partout. Il moissonne, il vendange. Chaque fois on l'apprécie. Mais il n'aime guère s'attarder. « A Vinsobres, j'ai eu un patron qui me disait « installe toi, reste dans le coin, on te facilitera les choses ». Mais non! Je suis un peu comme un gitan. Au bout de quelques temps, je voulais repartir sur le trimard ». Des années plus tard, son patron de Vinsobres fera une confidence à Etienne Audibert, de Suze: « Celui là, s'il avait voulu, il serait devenu l'homme le plus riche de Vinsobres! »
La paix revenue, il faut trouver un métier. Et, décidément, le goût des grands espaces acquis dans l'adolescence lui reste. Il aura bien l'occasion de se faire embaucher dans un immense consortium sidérurgique, à Rombas, à la frontière luxembourgeoise, « grand comme d'ici à Montélimar, avec des trains qui le sillonnaient ». Mais il y fait trop froid, il y a du brouillard et puis non décidément, ça n'est pas son monde! « J'ai eu un copain qui est allé se faire embaucher aux mines de Saint-Etienne. Je lui ai dit « vas-y, tu n'es pas prêt de m'y voir » ». Alors, il va de ferme en ferme, en Languedoc, en Seine et Marne, un peu partout. Il moissonne, il vendange. Chaque fois on l'apprécie. Mais il n'aime guère s'attarder. « A Vinsobres, j'ai eu un patron qui me disait « installe toi, reste dans le coin, on te facilitera les choses ». Mais non! Je suis un peu comme un gitan. Au bout de quelques temps, je voulais repartir sur le trimard ». Des années plus tard, son patron de Vinsobres fera une confidence à Etienne Audibert, de Suze: « Celui là, s'il avait voulu, il serait devenu l'homme le plus riche de Vinsobres! » ANGUILLES A LA MATELOTTE.-Mais le goût de la route est là, même si Marcel Bertonnier s'est tout de même installé à Gigors où, à la mauvaise saison, il va donner un coup de mains aux paysans dans les montagnes. Aux beaux jours, il file près de Béziers faire les vendanges: « C'était rude! Des heures et des heures à porter à deux des bacs de 80 kilos ». Ailleurs, dans la région parisienne, ce sont les moissons. « Ah, couper la paille, ça c'était dur. Pas de machine dans ce temps là. Tout à la main. » Mais il faut dire que le gaillard était costaud « Quatre vingt kilos, pas un poil de graisse ». Alors, on l'aimait bien. « J'ai eu un patron en Seine et Marne qui m'envoyait un billet de train pour que je revienne. » N'empêche que souvent la nuit c'est sur la paille. Et il se souvient encore avec tendresse de ce patron qui, lui du moins, le nourrissait avec le même menu que le sien « Ah, ces anguilles à la matelotte... ».
ANGUILLES A LA MATELOTTE.-Mais le goût de la route est là, même si Marcel Bertonnier s'est tout de même installé à Gigors où, à la mauvaise saison, il va donner un coup de mains aux paysans dans les montagnes. Aux beaux jours, il file près de Béziers faire les vendanges: « C'était rude! Des heures et des heures à porter à deux des bacs de 80 kilos ». Ailleurs, dans la région parisienne, ce sont les moissons. « Ah, couper la paille, ça c'était dur. Pas de machine dans ce temps là. Tout à la main. » Mais il faut dire que le gaillard était costaud « Quatre vingt kilos, pas un poil de graisse ». Alors, on l'aimait bien. « J'ai eu un patron en Seine et Marne qui m'envoyait un billet de train pour que je revienne. » N'empêche que souvent la nuit c'est sur la paille. Et il se souvient encore avec tendresse de ce patron qui, lui du moins, le nourrissait avec le même menu que le sien « Ah, ces anguilles à la matelotte... ».S'il n'avait pas été ouvrier agricole, Marcel Bertonnier aurait du être journaliste, écrivain peut être même. Parce qu'il a une manière de génie de l'observation, une drôlerie pour croquer les hommes et les situations. Comme ce patron, assis sur l'aile de sa voiture, chaussé de bottes superbes qui lui dit:
-
Je te préviens ici, si on est pas content, on te vire tout de suite
Et lui de répondre:
-
Ca tombe bien, moi quand je me plais pas, je ne suis pas long à partir.
Et, on s'en doute, ces deux hommes se sont bien entendus. Ou bien c'est un riche propriétaire dont il raconte des chasses avec des « grossiums », comme il dit. « Ils avaient fait ménager, en pleine nature, des portes en bois où chaque invité était placé. Les gardes chasses rabattaient le gibier qui pullulait et les gars avaient en tout et pour tout à s'agenouiller pour tirer. Tu parles d'un effort! Et lorsqu'ils en ont eu assez ils ont été festoyer avec des jeunes dames! »
 DES SQUELETTES EN RAYONS DE SOLEIL.-Autour de la quarantaine, Marcel Bertonnier s'est un peu lassé et a saisi l'opportunité de devenir fossoyeur pour une dizaine de communes, notamment Cobonne, Suze, Plan de Baix, mais parfois plus loin encore comme Aubenasson. « Un jour, pour les funérailles d'une comtesse, j'ai trouvé là bas, en creusant des squelettes disposés comme les rayons du soleil, autour d'une pierre. C'est une pratique gauloise. Un de mes amis avait fait la même constatation sur le plateau d'Anse, au dessus d'Omblèze ». Et ce fossoyeur curieux de tout va enregistrer toute ses découvertes. « A Suze, la chapelle du cimetière de Chausséon doit dater de Charlemagne. Un jour, en creusant, j'ai trouvé une sépulture protégé par des lauzes, comme on faisait jadis, mais d'un incroyable étroitesse. On n'aurait jamais pu y mettre un homme. Sauf si ce n'était que des ossements, après qu'on ait brulé le corps, comme ce fut le cas, au moment de la grande peste ».
DES SQUELETTES EN RAYONS DE SOLEIL.-Autour de la quarantaine, Marcel Bertonnier s'est un peu lassé et a saisi l'opportunité de devenir fossoyeur pour une dizaine de communes, notamment Cobonne, Suze, Plan de Baix, mais parfois plus loin encore comme Aubenasson. « Un jour, pour les funérailles d'une comtesse, j'ai trouvé là bas, en creusant des squelettes disposés comme les rayons du soleil, autour d'une pierre. C'est une pratique gauloise. Un de mes amis avait fait la même constatation sur le plateau d'Anse, au dessus d'Omblèze ». Et ce fossoyeur curieux de tout va enregistrer toute ses découvertes. « A Suze, la chapelle du cimetière de Chausséon doit dater de Charlemagne. Un jour, en creusant, j'ai trouvé une sépulture protégé par des lauzes, comme on faisait jadis, mais d'un incroyable étroitesse. On n'aurait jamais pu y mettre un homme. Sauf si ce n'était que des ossements, après qu'on ait brulé le corps, comme ce fut le cas, au moment de la grande peste ».A force de retourner la terre, Marcel Bertonnier s'est passionné pour les pièces qu'il y trouvait. Il tend son porte clef. On y voit d'étranges cercles dorés, des rouelles, « des prémonnaies », comme il dit. « Je le ai trouvées mélangées à des pièces gauloises. On peut donc penser que ça remonte au tout début de l'apparition de la monnaie pour les échanges ». D'une vieille boîte de cigares métalliques, il sort d'autres prises qu'il a faites, des pierres taillées, nettement antérieures, qui témoignent du temps où on les utilisait à défaut de maîtriser encore le métal. Et à force d'avoir trotté dans la région, à force d'y avoir ramassé des morceaux de tuiles, il s'est forgé une conviction: « IL devait y avoir un village romain plus grand que le vieux village de Beaufort, plus loin en allant vers Plan de Baix, dans la combe qui sépare cette route de celle de l'Escoulin ».
 RACHETE MA SELLE.- Et comme, avec ce mystérieux conteur, tout est toujours affaire de belles histoires, ne manquons pas celle-ci qui concerne Mandrin, le fameux bandit du XVIII° siècle, dont Marcel Bertonnier connaît les chemins d'accès au Vercors. « On a bien connu dans la région, une famille très fortunée, les Gailhard-Bancel. Un de leurs ancêtres avait protégé Mandrin. Le jour où il fut roué vif à Valence, il passa, en allant à son supplice, devant son ancien protecteur et lui souffla « Rachète ma selle ». Ce que le Gailhard-Bancel en question fit, lors de la dispersion des biens du brigand. Et il se dit que dans la selle se trouvaient les plans conduisant au trésor de Mandrin. D'où la fortune familiale... »
RACHETE MA SELLE.- Et comme, avec ce mystérieux conteur, tout est toujours affaire de belles histoires, ne manquons pas celle-ci qui concerne Mandrin, le fameux bandit du XVIII° siècle, dont Marcel Bertonnier connaît les chemins d'accès au Vercors. « On a bien connu dans la région, une famille très fortunée, les Gailhard-Bancel. Un de leurs ancêtres avait protégé Mandrin. Le jour où il fut roué vif à Valence, il passa, en allant à son supplice, devant son ancien protecteur et lui souffla « Rachète ma selle ». Ce que le Gailhard-Bancel en question fit, lors de la dispersion des biens du brigand. Et il se dit que dans la selle se trouvaient les plans conduisant au trésor de Mandrin. D'où la fortune familiale... »
 EN PUBLIANT CE TEXTE, J'OFFRE GRATUITEMENT UN ÉLÉMENT DES ARCHIVES DU CRESTOIS. MAINTENONS DANS NOTRE RÉGION UN JOURNAL INDÉPENDANT QUI NOUS SOUTIENT.
EN PUBLIANT CE TEXTE, J'OFFRE GRATUITEMENT UN ÉLÉMENT DES ARCHIVES DU CRESTOIS. MAINTENONS DANS NOTRE RÉGION UN JOURNAL INDÉPENDANT QUI NOUS SOUTIENT. 2 commentaires
2 commentaires
-
-
Par gervanne le 12 Septembre 2014 à 23:27

 Dans le petit coin de Drôme où je vis, a longtemps vécu, une de ces belles figures de la campagne qui ont travaillé durement pour nourrir les leurs. Il s'appelait Fernand Raillon et, en 2010, je lui avais consacré dans Le Crestois, l'hebdomadaire local, un portrait. Il est mort cette année 2014, au terme d'une ultime période passée dans une maison de retraite de Bourdeaux. Les échos de ces derniers mois que m'en laissait sa famille emplissaient de tristesse.
Dans le petit coin de Drôme où je vis, a longtemps vécu, une de ces belles figures de la campagne qui ont travaillé durement pour nourrir les leurs. Il s'appelait Fernand Raillon et, en 2010, je lui avais consacré dans Le Crestois, l'hebdomadaire local, un portrait. Il est mort cette année 2014, au terme d'une ultime période passée dans une maison de retraite de Bourdeaux. Les échos de ces derniers mois que m'en laissait sa famille emplissaient de tristesse.Je reprends ici, en l'enrichissant puisque la place ne m'est pas comptée, de quelques souvenirs, le texte paru en 2010. « Fernand Raillon reçoit , dans la très haute demeure, à la facade sévère du centre de Beaufort qui fut jadis une auberge. Sa devise était « On loge à pied et à cheval chez Malleval ». Le nom vient de la famille de son exquise épouse, Lucie, hélas trop tôt disparue et dont tout Beaufort se souvient comme d’une femme solide et généreuse. Elle a élevé dix enfants, quatre auxquels elle a donné vie, trois garçons et une fille, et six qui étaient des enfants de l’Assistance, comme on disait alors. « Fallait les tenir » se souvient aujourd’hui Fernand Raillon qui a eu droit au plus beau compliment de l’un d’entre eux, des années plus tard : « Ah, si tu ne nous avais pas dressés, on aurait fait de belles bêtises ».
Fernand Raillon reçoit aujourd’hui, dans sa cuisine. Il porte une veste qui fût tricotée par Lucie et qui est comme un rappel de tous les instants de cette femme auquel il fut tant lié. Sa chaise est adossée à une cuisinière qui diffuse une belle chaleur dans ce qui fut jadis la salle de l’auberge. Au moment des grands froids de 1956, malgré les bâches qu’on avait mises contre la porte-fenêtre qui donnait sur la rue, il y faisait…4°.Dans l’étable, non loin, c’était un peu mieux, 8°, parce que les vaches dégageaient de la chaleur. L’anecdote est à la mesure de la dureté des temps qu’a traversés Fernand Raillon.
 PAS D’EAU COURANTE.- Il est né à Montclar en 1918. Au début des années trente, ses parents s’installent sur le plateau des Chaux, au dessus de Beaufort, non loin des fameux Trois Prés, qui sont un repère connu de tous les gens de la région. Il va à l’école à Lozeron. « En ce temps là, rappelle-t-il, il y avait des écoles dans tous les villages ». Il va aider, ainsi que son frère, pendant quelques années son père à la ferme et prendre très tôt le goût de la chasse qui ne l’a pas quitté. « J’ai eu mon premier permis à 18 ans » et aujourd’hui encore, son fils Gérard ou un de ses petits fils passent le prendre pour l’emmener faire le coup de feu. « Mais cette année, je n’ai pas tiré un coup de fusil. Pourtant, j’ai vu deux lièvres. Mais je préfère le lapin de garenne ».
PAS D’EAU COURANTE.- Il est né à Montclar en 1918. Au début des années trente, ses parents s’installent sur le plateau des Chaux, au dessus de Beaufort, non loin des fameux Trois Prés, qui sont un repère connu de tous les gens de la région. Il va à l’école à Lozeron. « En ce temps là, rappelle-t-il, il y avait des écoles dans tous les villages ». Il va aider, ainsi que son frère, pendant quelques années son père à la ferme et prendre très tôt le goût de la chasse qui ne l’a pas quitté. « J’ai eu mon premier permis à 18 ans » et aujourd’hui encore, son fils Gérard ou un de ses petits fils passent le prendre pour l’emmener faire le coup de feu. « Mais cette année, je n’ai pas tiré un coup de fusil. Pourtant, j’ai vu deux lièvres. Mais je préfère le lapin de garenne ».C’est donc son mariage avec la merveilleuse Lucie qui va l’amener à Beaufort. C’est un temps –l’avant guerre et même au-delà- où il n’ y a pas d’eau courante à Beaufort. On va s’approvisionner à des fontaines. Il faut souvent faire la queue, surtout au moment des grandes chaleurs. « Avec les bêtes qu’il fallait faire boire, c’était pénible ». Il faudra, après le conflit mondial, toute l’habileté de Henri Morin devenu maire, pour changer la situation. Les plus anciens du pays se souviennent encore, pour s’en amuser, d’une polémique qui agita alors la région lorsque la commune acheta, mine de rien, un terrain à Suze, la commune voisine, terrain dont le vrai trésor était le sous sol. Il y avait une source.. C’est elle qui a approvisionné la commune en eau. « Et il a fallu que trois malheureux Italiens creusent toute la tranchée à la main, à un mètre de profondeur pour y mettre la canalisation ». Fernand Raillon le répète souvent : « C’était tout à bras. Pas de machine ».
Il faut dire qu’il parle d’expérience. Car, pour faire tourner la petite exploitation de son beau-père tombé malade, il l’a fait de ses mains. « Au début, j’ai attelé les vaches. Mais ça n’était pas bon pour la production de lait. Alors j’ai acheté deux chevaux. C’était
 rudement plus commode. »
rudement plus commode. »Tout cela faisait vivre quelques artisans : il y avait deux maréchaux ferrants. Léopold* et Charles Colomb fabriquaient même sur place des charrettes ou cerclaient les roues de métal, après avoir chauffé la bande métallique pour qu’elle se dilate. On jetait de l’eau sur le métal rougi, une fois que le cercle était bien en place, pour provoquer sa rétraction rapide et ainsi le faire tenir. « On n’avait pas beaucoup de souci avec les charrettes, mais bien sûr, fallait pas verser. Parfois on cassait une roue. » Et il fallait retourner voir les Colomb. Les photos que je publie ici, du fonds Édouard Mouriquand ont été prises à Beaufort à la toute fin des années 40 et représentent à l'évidence des maréchaux ferrants. Il se peut bien que ce soient les Colomb

 DES BALLES DE 100 KILOS SUR LE DOS.- Leur métier a disparu comme les trois cordonniers, les trois épiceries, sans compter les bistrots dont on voit encore des traces en regardant très attentivement les façades du village où se devinent des enseignes que le temps efface.
DES BALLES DE 100 KILOS SUR LE DOS.- Leur métier a disparu comme les trois cordonniers, les trois épiceries, sans compter les bistrots dont on voit encore des traces en regardant très attentivement les façades du village où se devinent des enseignes que le temps efface.Faute de machine, il y avait les coups de mains entre les hommes. Fernand Raillon évoque volontiers la solide camaraderie qui le liait à Abel Lacroix, un autre agriculteur, dont les anciens se souviennent bien, lui et son imposante Citroën 15 CV. Ceux qui se souviennent de cet Abel là, revoient sa maison au coeur du village dans laquelle on entrait par le garage en longeant donc l'énorme Citroën 15, puis on entrait dans la cuisine où régnait une chaleur étouffante. « Au moment où il fallait battre la récolte de blé, on se donnait la main », poursuit Fernand Raillon. Ca durait bien un mois autour du 14 juillet, puisque ça se prolongeait même au-delà de l’ancienne vogue du village, le 31 juillet. « Les grains étaient vendus à la coopérative de Crest. Deux gars venaient en camion charger des balles de 100 kilos, qu’ils chargeaient sur leur dos. » Fernand Raillon reste rêveur un instant et ajoute : « Ca, je peux vous dire, c’était des gars solides »
L’après guerre fut un temps où se trouvaient au village des prisonniers de guerre qui aidaient dans les fermes au titre de la reconstruction. Il en reste une trace aujourd’hui encore au champ de foire de Beaufort avec le long bâtiment aveugle où, longtemps, les sapeurs-pompiers du village ont entreposé du matériel. Il y en avait alors plusieurs identiques à cet endroit où vivaient les prisonniers nourris par un cuisinier français. « Il y en avait des braves. Je me souviens d’un qui disait « moi la guerre, je l’aurais jamais faite ». Mais ils n’étaient pas tous comme ça. Il y avait des rudes gaillards aussi, des sacrés têtes carrées».
Le champ de foire, où étaient abrités ces prisonniers, avaient bien mérité son nom. « Il y avait cinq foires avant guerre. Le village était envahi de gens qui venaient de partout avec des troupeaux à vendre, avec des poules et des canards. Après guerre, les camions ont permis de transporter les animaux et les foires ont disparu ».
Et on a commencé à voir circuler des tracteurs. C’est au début des années 60, que Fernand Raillon a eu son premier. « Un Mc Cormick de 20 CV. Je suis resté fidèle à la marque par la suite. » Car, ultérieurement Fernand Raillon a pu en acheter un de 30 CV et finalement, en 1970 environ, un de 52 CV qu’il a toujours, même si, bien sûr, il ne s’en sert plus. « Ca permettait d’avoir deux socs pour labourer. Je l’ai payé deux millions de francs de l’époque ». Alors, les chevaux, bien sûr, sont passés de mode. Mais les vaches, elles, mettaient du beurre dans les épinards et sont restées. Chaque matin, il y avait une petite queue devant chez les Raillon pour venir y acheter le lait.
 LE LINGE DANS LA BROUETTE.- La vie était rude aussi pour les femmes. Longtemps, on est allé laver à la Scie, en contrebas. « Lucie mettait le linge sur une brouette et puis elle poussait. Des fois, je pouvais l’accompagner avec la charrette. » Lorsqu’on lui pose la question de savoir si cette vie était dure, Fernand Raillon qui n’est pas homme à se plaindre répond sans détour : « Oui, c’était très dur ». Et il y revient : « C’était tout à bras. »
LE LINGE DANS LA BROUETTE.- La vie était rude aussi pour les femmes. Longtemps, on est allé laver à la Scie, en contrebas. « Lucie mettait le linge sur une brouette et puis elle poussait. Des fois, je pouvais l’accompagner avec la charrette. » Lorsqu’on lui pose la question de savoir si cette vie était dure, Fernand Raillon qui n’est pas homme à se plaindre répond sans détour : « Oui, c’était très dur ». Et il y revient : « C’était tout à bras. »Mais, il y avait, en compensation la chaleur d’une famille où tout le monde a fini par trouver une place dans la vie. Noël Raillon a longtemps été facteur à La Clastre où la population se souvient encore de son dévouement. André fut pompier à Paris, avant de se réinstaller dans la région. Madeleine a travaillé dans les hôpitaux à Lyon, mais elle aussi est revenue à l’âge de la retraite et Georges travaille dans une entreprise de bâtiment d’Aouste.
Et tous ceux qui connaissent un peu cette nichée, voient régulièrement des voitures arrêtées devant la haute façade grise. Ce ne sont plus – et depuis bien longtemps- des clients de l’Auberge Malleval. Ce sont les enfants et les petits enfants de ce patriarche courageux qui viennent écouter ces si belles histoires.
*Michèle Colomb Nottet, petite fille de Léopold, m'adressa une correspondance à la suite de la parution de cette article dans lequel elle le décrivait comme un « génial bricoleur qui a inventé une machine à laver » (en un temps, rappelons le, où cela n’existait pas) « qui fabriquait des vélos pour sa famille, qui arrangeait les automobiles, allant même jusqu’à les recarosser. Musicien à ses heures, puisqu’il avait dirigé l’harmonie du village, il était né le 19 août 1889 à Beaufort. Eugène Charles Alexandre était aussi charron et cousin du premier.

 EN PUBLIANT CE TEXTE, J'OFFRE GRATUITEMENT UN ÉLÉMENT DES ARCHIVES DU CRESTOIS. MAINTENONS DANS NOTRE RÉGION UN JOURNAL INDÉPENDANT QUI NOUS SOUTIENT.
EN PUBLIANT CE TEXTE, J'OFFRE GRATUITEMENT UN ÉLÉMENT DES ARCHIVES DU CRESTOIS. MAINTENONS DANS NOTRE RÉGION UN JOURNAL INDÉPENDANT QUI NOUS SOUTIENT.  votre commentaire
votre commentaire
-
Par gervanne le 12 Septembre 2014 à 23:02
 Je poursuis ici la republication de portraits de gens que j'ai aimés, portraits qui ont été publiés dans Le Crestois, dans les années passées. En l'espèce, il s'agit ici du dernier des Lapra, de cette formidable dynastie de quincaillers, de Crest. Leur magnifique demeure probablement renaissance reste à ma connaissance à vendre au centre de la vieille ville. Et la nostalgie est toujours là de cette véritable antre où l'on trouvait de tout est entière. Cet article a été publié en septembre 2012.
Je poursuis ici la republication de portraits de gens que j'ai aimés, portraits qui ont été publiés dans Le Crestois, dans les années passées. En l'espèce, il s'agit ici du dernier des Lapra, de cette formidable dynastie de quincaillers, de Crest. Leur magnifique demeure probablement renaissance reste à ma connaissance à vendre au centre de la vieille ville. Et la nostalgie est toujours là de cette véritable antre où l'on trouvait de tout est entière. Cet article a été publié en septembre 2012. "Aujourd'hui, François Lapra et son épouse vivent à Portes les Valence et nous sommes tristes. Parce que cinquante ans ans durant, à Crest, aller chez les Lapra c'était aussi compréhensible pour chaque Crestois qu'aller à la mairie ou à l'hôpital. Les Lapra tenaient la quincaillerie centrale de Crest, dans la rue de l'Hôtel de Ville, incroyable grotte où l'on trouvait absolument de tout, où les objets se serraient sur les étagères. Lorsqu'il n'y avait plus de place, François Lapra stockait dans les étages. « Et il arrivait trop souvent, dit-il aujourd'hui en souriant, que lorsque je venais de monter chercher un objet dans les étages, le client me dise, une fois que j'étais redescendu « Ah, j'avais oublié de vous dire qu'il me fallait aussi... », et, hop!, il fallait que je remonte les escaliers. »
"Aujourd'hui, François Lapra et son épouse vivent à Portes les Valence et nous sommes tristes. Parce que cinquante ans ans durant, à Crest, aller chez les Lapra c'était aussi compréhensible pour chaque Crestois qu'aller à la mairie ou à l'hôpital. Les Lapra tenaient la quincaillerie centrale de Crest, dans la rue de l'Hôtel de Ville, incroyable grotte où l'on trouvait absolument de tout, où les objets se serraient sur les étagères. Lorsqu'il n'y avait plus de place, François Lapra stockait dans les étages. « Et il arrivait trop souvent, dit-il aujourd'hui en souriant, que lorsque je venais de monter chercher un objet dans les étages, le client me dise, une fois que j'étais redescendu « Ah, j'avais oublié de vous dire qu'il me fallait aussi... », et, hop!, il fallait que je remonte les escaliers. »  L'histoire des Lapra et de leur magasin est une histoire invraisemblable. En effet, le magasin aujourd'hui tristement fermé, ouvre en vérité en 1860 avec un premier quincailler. On en a hélas perdu le nom, mais pas forcément la photo, en effet, les Lapra possèdent une photo – celle que nous publions- d'un quincailler devant la fameuse devanture et qui est peut être la personne en question à moins que ce ne soit un des successeurs MM. Brus et Roussin. C'est en tous cas à M. Roussin que Jacques Lapra, le père de François, reprend l'affaire en 1956. Et l'amusant de l'affaire est que Jacques Lapra lui-même était d'une famille de quincailler en gros à Feurs dans la Loire depuis plusieurs générations. En sorte qu'il n'est pas interdit de penser que lorsque, pour la première fois dans cet emplacement du centre ville de Crest, s'ouvrit une quincaillerie, quelque part dans la Loire, pour la première fois, un Lapra se lançait dans le métier dans la Loire. En gros, les périodes coïncident.
L'histoire des Lapra et de leur magasin est une histoire invraisemblable. En effet, le magasin aujourd'hui tristement fermé, ouvre en vérité en 1860 avec un premier quincailler. On en a hélas perdu le nom, mais pas forcément la photo, en effet, les Lapra possèdent une photo – celle que nous publions- d'un quincailler devant la fameuse devanture et qui est peut être la personne en question à moins que ce ne soit un des successeurs MM. Brus et Roussin. C'est en tous cas à M. Roussin que Jacques Lapra, le père de François, reprend l'affaire en 1956. Et l'amusant de l'affaire est que Jacques Lapra lui-même était d'une famille de quincailler en gros à Feurs dans la Loire depuis plusieurs générations. En sorte qu'il n'est pas interdit de penser que lorsque, pour la première fois dans cet emplacement du centre ville de Crest, s'ouvrit une quincaillerie, quelque part dans la Loire, pour la première fois, un Lapra se lançait dans le métier dans la Loire. En gros, les périodes coïncident.
Chez Lapra, il y avait tout: de l'outillage, de la boulonnerie, du verre découpé à la demande, de la ferraille, des fers à chevaux, des pointes, du matériel électro-ménager, des cuisinières à charbon, des tuyaux de poêles dont Francois Lapra, fermant les yeux, se remémore les 15 dimensions disponibles. Et ce n'est qu'un petit échantillon de cet caverne d'Ali Baba qui, pourtant, ne faisait que 110 m2. Le magasin était le Vatican du boulon et François Lapra en était le pape. Un pape bonhomme, du reste qui, lorsqu'il vendait une serrure disait à son client: « Allez l'essayer chez vous et si ça ne va pas vous me la ramènerez. » Ou bien qui, ayant reçu une commande transmise par le chauffeur du car allait lui porter le colis à mener dans les villages éloignés avant qu'il ne parte. « Place des Moulins c'était pour les cars en direction de Saillans et de Die, sur les quais pour le car vers Bourdeaux. » Mais le gros des ventes, bien sûr, se faisait le samedi lorsque les clients descendaient de leurs villages. Mme. Lapra, qui secondait son mari, se prend le visage dans les mains: « C'était l'horreur, il y avait un monde fou. Il ne fallait pas attendre cinq minutes après 8h . pour ouvrir. » Et la journée continuait jusqu'à 19h. Il n'y avait pas de petits clients, on pesait vis et clous parfois pour des quantités dérisoires. Tout se vendait à l'unité, à l'inverse des pratiques actuelles de la grande distribution.
Un pape bonhomme, du reste qui, lorsqu'il vendait une serrure disait à son client: « Allez l'essayer chez vous et si ça ne va pas vous me la ramènerez. » Ou bien qui, ayant reçu une commande transmise par le chauffeur du car allait lui porter le colis à mener dans les villages éloignés avant qu'il ne parte. « Place des Moulins c'était pour les cars en direction de Saillans et de Die, sur les quais pour le car vers Bourdeaux. » Mais le gros des ventes, bien sûr, se faisait le samedi lorsque les clients descendaient de leurs villages. Mme. Lapra, qui secondait son mari, se prend le visage dans les mains: « C'était l'horreur, il y avait un monde fou. Il ne fallait pas attendre cinq minutes après 8h . pour ouvrir. » Et la journée continuait jusqu'à 19h. Il n'y avait pas de petits clients, on pesait vis et clous parfois pour des quantités dérisoires. Tout se vendait à l'unité, à l'inverse des pratiques actuelles de la grande distribution.
 Au début, le magasin n'était fermé que le dimanche. Leurs filles grandissant, François Lapra est allé les conduire à l'école le lundi matin, son épouse ayant longtemps exercé une profession médicale avant de le rejoindre définitivement derrière le comptoir. Mais, pas de fermeture l'été. « C'était un temps, disent-ils, unanimes, où la vitalité du commerce crestois était formidable. » « Moi qui venais de Portes les Valence, dit Mme Lapra, je n'en revenais pas. » Il était alors encore possible de se faire livrer commodément dans la rue. « C'est vrai, poursuit Mme. Lapra, qu'il y avait de terribles embouteillages. La rue était bombée donc les camions de livraison penchaient dangereusement. Les commerçants sortaient regarder les manoeuvres en tremblant pour leurs enseignes. Mais la fermeture à la circulation a incontestablement affecté l'activité. » C'était le temps où il y avait dix sept épiceries à Crest qui, toutes, s'en sortaient et animaient notablement la ville. « L'union commerciale marchait à fond », se souvient François Lapra. « Un des problèmes est qu'il y a eu une génération de commerçants qui sont tous arrivés à peu près au même moment à la retraite. Et ils n'ont pas trouvé successeur. D'où l'impression qu'on a aujourd'hui de très nombreux magasins fermés. »"
Au début, le magasin n'était fermé que le dimanche. Leurs filles grandissant, François Lapra est allé les conduire à l'école le lundi matin, son épouse ayant longtemps exercé une profession médicale avant de le rejoindre définitivement derrière le comptoir. Mais, pas de fermeture l'été. « C'était un temps, disent-ils, unanimes, où la vitalité du commerce crestois était formidable. » « Moi qui venais de Portes les Valence, dit Mme Lapra, je n'en revenais pas. » Il était alors encore possible de se faire livrer commodément dans la rue. « C'est vrai, poursuit Mme. Lapra, qu'il y avait de terribles embouteillages. La rue était bombée donc les camions de livraison penchaient dangereusement. Les commerçants sortaient regarder les manoeuvres en tremblant pour leurs enseignes. Mais la fermeture à la circulation a incontestablement affecté l'activité. » C'était le temps où il y avait dix sept épiceries à Crest qui, toutes, s'en sortaient et animaient notablement la ville. « L'union commerciale marchait à fond », se souvient François Lapra. « Un des problèmes est qu'il y a eu une génération de commerçants qui sont tous arrivés à peu près au même moment à la retraite. Et ils n'ont pas trouvé successeur. D'où l'impression qu'on a aujourd'hui de très nombreux magasins fermés. »"
 EN PUBLIANT CE TEXTE, J'OFFRE GRATUITEMENT UN ÉLÉMENT DES ARCHIVES DU CRESTOIS. MAINTENONS DANS NOTRE RÉGION UN JOURNAL INDÉPENDANT QUI NOUS SOUTIENT.
EN PUBLIANT CE TEXTE, J'OFFRE GRATUITEMENT UN ÉLÉMENT DES ARCHIVES DU CRESTOIS. MAINTENONS DANS NOTRE RÉGION UN JOURNAL INDÉPENDANT QUI NOUS SOUTIENT.
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Histoire,politique, géopolitique, questions religieuses, univers des médias, petites nouvelles de la Drôme